La revue de web de Kat
Publié par Raphaël Llorca le 10 janvier 2026
*24 décembre 1941, Atlantique Nord. Il est trois heures du matin, il fait un froid glacial. Au large de Terre-Neuve, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est encore plongé dans la nuit. À la sortie du port, le capitaine d’un petit chalutier n’en croit pas ses yeux : il vient de croiser quatre bâtiments de guerre — trois corvettes et un imposant croiseur sous-marin, coiffé d’un énorme canon. À l’avant, un pavillon claque au vent : bleu blanc et rouge, frappé de la croix de Lorraine en son centre — le drapeau des Forces navales françaises libres.-
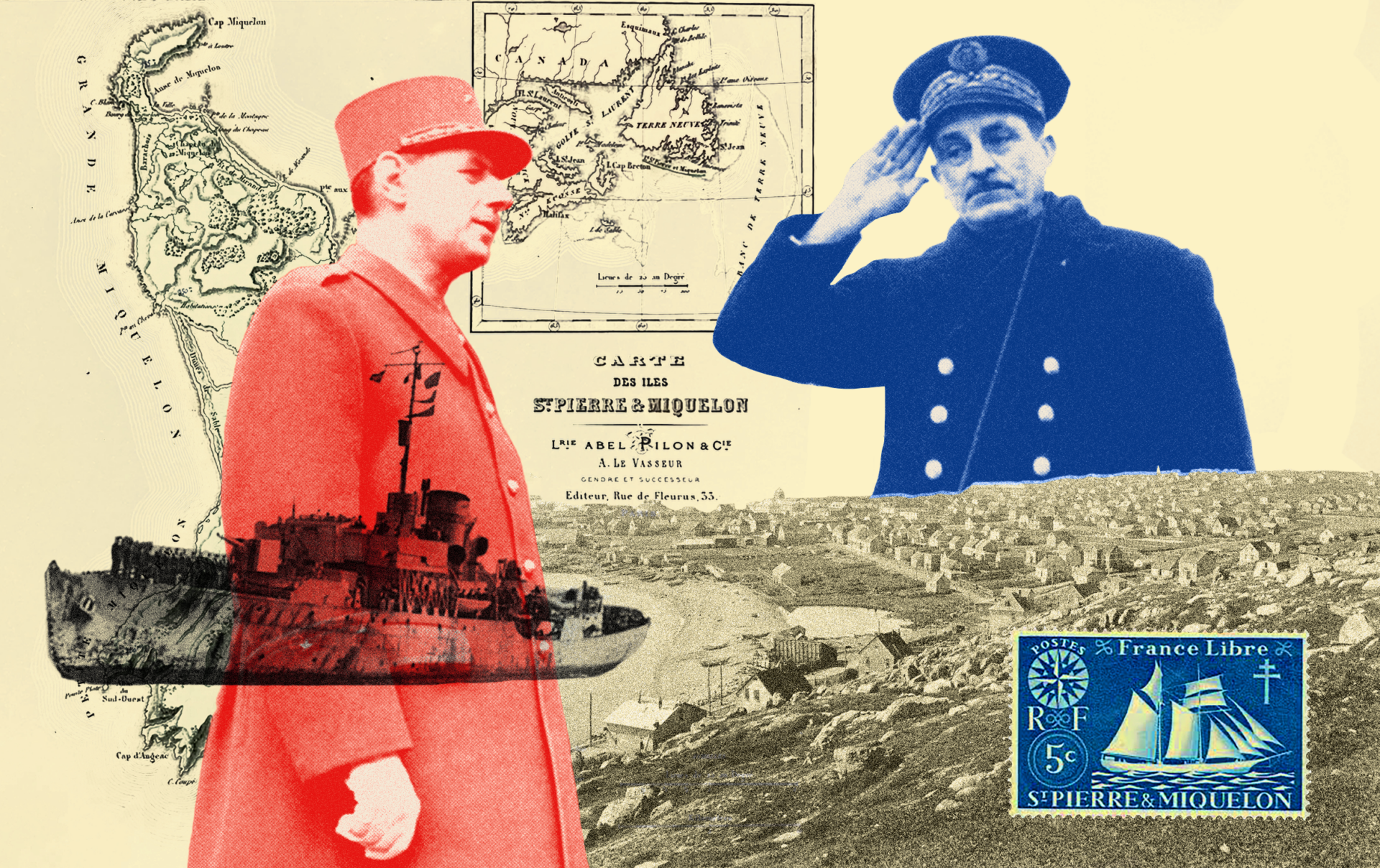
L’entrée dans le port se fait en quelques minutes, et suit un plan bien ordonné.
Une première corvette, la Mimosa, reçoit l’ordre de verrouiller le secteur des douanes ; une deuxième, l’Alysse, file vers le vieux bâtiment des douaniers pour en prendre possession ; la troisième, l’Aconit, se place à l’embarcadère, en couverture. Le sous-marin Surcouf, lui, reste en sentinelle à l’entrée du port.
Si, comme l’écrivait Malaparte 1, le coup d’État est une technique, alors ceux qui exécutent les manœuvres dans ce port la maîtrisent à la perfection.
Bientôt, vingt-cinq hommes armés débarquent et prennent méthodiquement possession des lieux stratégiques : la centrale téléphonique, la station de radio, le poste du câble transatlantique, puis la gendarmerie et les bureaux du gouvernement. Le seul gendarme croisé à cette heure avancée de la nuit se rend sans résistance.
En moins d’une demi-heure, sans un coup de feu tiré, l’affaire est pliée : Saint-Pierre-et-Miquelon devient le premier territoire libéré par la France libre. Comme une traînée de poudre, la nouvelle du débarquement se répand en ville.
Les premiers habitants enthousiastes sortent de leur lit, bottés, emmitouflés, se massent le long des bassins enneigés pour crier : « Vive de Gaulle ! »
Un militaire s’avance, un haut gradé. C’est lui, comprend-t-on, qui a conduit l’opération.
L’amiral Émile Muselier déplie une feuille et lit d’une voix calme une déclaration solennelle à la population :
« Habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon : conformément aux ordres du général de Gaulle, je suis venu pour vous permettre de participer librement et dans l’ordre au plébiscite que vous réclamez depuis si longtemps. Vous aurez à choisir entre la cause de la France libre et la collaboration avec les puissances qui affament, humilient et martyrisent notre patrie. Je ne doute pas que le plus ancien de nos territoires d’outre-mer, se rangeant aux côtés de la Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada, des autres Alliés, ne manifeste en masse sa fidélité aux traditions d’honneur et de liberté qui ont toujours été l’orgueil de la France. Vive la France ! Vivent les Alliés ! » 2
Le lendemain, jour de Noël, tous les hommes de plus de dix-huit ans sont appelés aux urnes.
À 17h30, sur la place centrale de la ville, anciennement appelée place Napoléon et bientôt rebaptisée place du général de Gaulle, l’amiral Muselier annonce les résultats.
Muselier utilise le référendum comme une arme diplomatique — et la mise en scène démocratique sert de piège moral tendu à l’allié.
Le verdict est sans appel : 783 voix pour la France libre, 14 voix pour la collaboration avec les puissances de l’Axe, 215 bulletins nuls 3.
98 % des votes exprimés ont émis le souhait de rejoindre les rangs des gaullistes, c’est un plébiscite.
Alain Savary, qui deviendra quarante ans plus tard ministre de l’Éducation de François Mitterrand, se voit chargé de l’administration temporaire de l’île.
Plusieurs prisonniers, soupçonnés de fidélité à Vichy, sont finalement relâchés. « Comme cadeau de Noël, leur dit l’amiral Muselier, la France libre vous offre ce qu’elle peut vous accorder : la liberté. » 4
La souveraineté n’est pas divisible
Quelle mouche a piqué le général de Gaulle pour qu’il décide d’envoyer, depuis Londres, une flottille militaire traverser l’Atlantique ?
Pour le comprendre, il faut se replonger dans le contexte géopolitique de l’époque.
Après l’armistice de juin 1940, Saint-Pierre-et-Miquelon, petit territoire français en Amérique du Nord — 240 kilomètres carrés, 4 600 habitants, à l’entrée de l’estuaire du Saint-Laurent — passe sous l’autorité du régime de Vichy. Le gouverneur-résident, le baron de Bournat, est décrit comme « marié à une Allemande et un puissant partisan du gouvernement de Vichy » 5. Sur le plan stratégique, l’archipel devient alors, mécaniquement, un point d’appui possible pour l’effort de guerre de l’Axe, notamment par le biais de ses moyens de communication.
Saint-Pierre est une station du câble transatlantique, et dispose d’un puissant émetteur radio.
Dans une guerre de l’Atlantique obsédée par la chasse aux convois, c’est un problème crucial : les Britanniques craignent qu’une enclave vichyste puisse renseigner les sous-marins allemands sur les routes, les horaires, la météo, les mouvements. La situation est concrètement très délicate : les Alliés peuvent-ils durablement accepter qu’une enclave potentiellement ennemie soit utilisée par l’Axe à l’entrée du continent américain ?
Dès la mi-1940, la question remonte donc à Ottawa et à Londres. Des pourparlers au sujet de Saint-Pierre-et-Miquelon sont entamés. L’ambassadeur américain au Canada, Jay Pierrepont Moffat, discute d’un projet d’occupation des îles avec les autorités canadiennes ; le Premier ministre Mackenzie King y renonce — redoutant qu’une intervention directe dans les îles ne détériore une situation diplomatique déjà instable.
En parallèle, Vichy cherche à sanctuariser ses possessions américaines.
En juillet 1940, Pétain obtient de Roosevelt une assurance : les États-Unis « ne reconnaîtront pas de changement de souveraineté des colonies des puissances européennes dans l’hémisphère occidental », et entendent les voir demeurer neutres. À ce moment, Washington n’est pas encore entré en guerre : la priorité américaine est de stabiliser son voisinage et de préserver ses marges de manœuvre diplomatiques.
Mais à mesure que les hostilités progressent, les Canadiens s’inquiètent de plus en plus du « nœud » saint-pierrais.
Le 3 novembre 1941, le gouvernement américain est informé de l’arrivée prochaine à Saint-Pierre de chargés de mission qui auraient à surveiller tous les messages envoyés et reçus. Pour Washington, la ligne rouge est atteinte : le département d’État américain envisage une expédition américano-canadienne visant à neutraliser le poste radio de Saint-Pierre.
De Gaulle ne « gagne » pas parce qu’il est plus fort ; il gagne parce qu’il refuse de parler comme un obligé. Raphaël Llorca
Informé, le général de Gaulle s’indigne de la perspective d’une intervention étrangère sur un territoire français.
Il comprend qu’il est confronté à un choix : une reprise française de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou une mise sous tutelle alliée. Il ordonne alors à l’amiral Muselier, commandant en chef des Forces navales françaises libres, d’appareiller sur le champ, sans obtenir l’accord de Washington.
Dans ses Mémoires de guerre, le général de Gaulle a cette formule : « Je tenais cet accord pour souhaitable, mais non indispensable, puisqu’il n’y avait là qu’une affaire intérieure française. » 6
Nous sommes ici au cœur de la matrice politique gaullienne : la souveraineté n’est pas divisible, donc elle ne se « partage » pas au gré des circonstances.
La logique du Général est celle d’un refus de précédent.
Si l’on admet qu’un débarquement peut se faire dans un territoire français sans les Français, on acte, au fond, que la France est un problème de police pour ses alliés — et non plus un sujet politique.
De Gaulle fixe alors un principe : on peut être dépendant militairement sans être soluble diplomatiquement.
Cette décision prendra toute sa portée au moment de la libération du territoire métropolitain, mais sa grammaire est déjà posée à l’hiver 1941.
Tempête diplomatique
À peine l’archipel « basculé », la nouvelle fait le tour du monde — au point d’être reprise, le 25 décembre 1941, en une du New York Times.
Dans son récit très enthousiaste des événements, Ira Wolfert, qui recevra deux années plus tard le prestigieux prix Pulitzer pour ses reportages de guerre dans le Pacifique, n’hésite pas à parler d’une « démonstration de force » :
« Les Forces françaises libres ont montré qu’elles avaient conservé la maîtrise de cet art militaire qu’une grande partie du monde pensait enseveli par les divisions de Panzer allemandes. L’expédition fut montée dans le plus grand secret, en rassemblant des moyens venus de multiples horizons. L’amiral Muselier et son état-major se rendirent sur zone depuis l’Angleterre à bord d’une corvette de 1 100 tonnes ; il affronta ce que ses compagnons de bord décrivirent comme ‘la pire tempête’ que l’Atlantique Nord ait connue cette année. » 7
Quelques années plus tard, l’historien Robert Aron parlera, lui, du « putsch de Saint-Pierre-et-Miquelon » 8 : un terme rugueux, mais révélateur de la perception de certains contemporains. Non pas une simple opération navale, mais une prise de pouvoir par surprise dans une zone que Washington entend traiter comme un prolongement de sa sécurité nationale — dans la tradition de la « doctrine Monroe » théorisée près de cent vingt ans plus tôt.
Inévitablement, l’événement provoque le courroux américain.
Les États-Unis viennent tout juste d’entrer en guerre aux côtés des Alliés après l’attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941 — trois semaines seulement auparavant — et voilà l’autorité du puissant allié contestée dans sa propre zone d’influence.
Le 25 décembre, le Secrétaire d’État américain, Cordell Hull, écourte ses vacances et rentre précipitamment à Washington.
Il publie un communiqué cinglant : l’action des « so-called Free French ships » est qualifiée d’« arbitraire », et dénoncée comme contraire à l’accord de toutes les parties intéressées, « sans que le gouvernement des États-Unis en ait eu connaissance ou ait exprimé son approbation ». Il demande ensuite au Canada de prendre des mesures pour « restaurer le statu quo dans l’archipel ». Autrement dit : le communiqué n’exprime pas seulement une réprobation, c’est une mise en demeure au Canada de remettre l’archipel au gouvernement de Vichy.
Au même moment, Winston Churchill se trouve en visite à Québec en compagnie du président Roosevelt.
Dans ses Mémoires de guerre, le Premier ministre britannique rapporte que l’expression « so-called » est très mal reçue par l’opinion publique américaine, qui y voit une contestation de la légitimité même de la France libre. L’effet boomerang est immédiat : une partie de la presse américaine se retourne contre Hull 9. Dans un éditorial publié dans Nation 10, Freda Kirchwey accuse le Secrétaire d’État de « poursuivre avec un entêtement ridicule sa politique de complaisance vis-à-vis de Vichy », et voit dans « la répudiation de la France libre à Saint-Pierre-et-Miquelon […] le symbole le plus effrayant de notre déchéance morale ».
L’incident fissure le récit d’unité que Roosevelt cherche à installer au lendemain de Pearl Harbor : Saint-Pierre-et-Miquelon devient l’objet d’une querelle de légitimité au sein même du front allié.
Début janvier 1942, une proposition présentée comme une offre de compromis par le départment d’État est adressée au Comité de la France libre : une mission canadienne surveillerait les moyens de communication de Saint-Pierre, tandis que les troupes de la France libre seraient priées de quitter l’archipel. L’objectif : une neutralisation stratégique des îles et l’indépendance de l’administration par rapport à de Gaulle. Pour y parvenir, les États-Unis passent par l’entremise du gouvernement britannique. À Londres, le ministre des Affaires étrangères britannique, Anthony Eden, vient trouver le Général, pour lui annoncer que les États-Unis songeaient à envoyer à Saint-Pierre un croiseur et deux destroyers.
La suite de l’échange, rapportée par de Gaulle, sonne comme une scène de théâtre politique :
« ‘Que ferez-vous, en ce cas ?’ me dit-il — Les navires alliés, répondis-je, s’arrêteront à la limite des eaux territoriales françaises et l’amiral américain ira déjeuner chez Muselier qui en sera certainement enchanté. — Mais si le croiseur dépasse la limite ? — Nos gens feront les sommations d’usage. — S’il passe outre ? — Ce serait un grand malheur, car, alors, les nôtres devraient tirer.’ M. Eden leva les bras au ciel. ‘Je comprends vos alarmes, concluai-je en souriant, mais j’ai confiance dans les démocraties.’ » 11
Dire qu’on tirera n’est pas une fanfaronnade : c’est définir, par les mots, ce qui relève de l’inacceptable — même sous protection, même dans un rapport de force défavorable, même dans une asymétrie de puissance manifeste.
Le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon rappelle une vérité élémentaire : la première puissance est grammaticale. Raphaël Llorca
Au moment précis où l’Amérique devient l’allié indispensable, de Gaulle refuse de traiter sa souveraineté comme une variable d’ajustement.
Il ne « marchande » rien, ne relie pas tous les sujets entre eux : il isole une ligne rouge, indépendamment du reste, et accepte l’idée d’une friction avec Washington, parce qu’il juge que céder ici, c’est préparer d’autres renoncements.
Sur place, Muselier se démultiplie, et comprend très vite que la bataille se joue aussi dans l’opinion publique américaine.
Aidé par Wolfert, le journaliste du New York Times gagné à sa cause, il réalise plusieurs enregistrements à destination des États-Unis.
Dans l’un d’eux, il durcit le registre jusqu’à l’absolu, en nouant explicitement Saint-Pierre-et-Miquelon à l’idée de « démocratie » :
« Il n’y a pas de puissance au monde qui puisse chasser mes hommes et moi-même de ces îles tant que nous serons vivants. Pour l’honneur, je résisterai à toute force navale quelle que soit sa puissance. Si, par une circonstance incroyable, une telle tentative devait être faite, alors c’est qu’il n’y aurait plus de démocratie sur la terre, et il ne resterait d’autre solution pour les démocrates que de mourir. Notre sang tacherait l’histoire, la démocratie serait notre linceul et notre tombe. » 12
Les trois leçons de la doctrine Muselier
Avant d’être un épisode d’histoire navale, Saint-Pierre-et-Miquelon est un petit traité de politique en actes. Une leçon de chose : comment, dans l’asymétrie la plus totale, fabriquer de la puissance avec presque rien.
Appelons cela la « doctrine Muselier » : l’art de transformer une opération limitée en événement total — en combinant un geste territorial (prendre), un geste symbolique (montrer), et un geste démocratique (faire voter), de façon à déplacer la bataille du terrain militaire vers celui de l’opinion publique.
De Gaulle y pose la règle, Muselier en orchestre la dramaturgie : ensemble, ils transforment un confetti atlantique en principe de souveraineté.
Trois leçons peuvent être tirées de cet épisode historique.
Première leçon : la puissance des mots — donc des principes.
Qu’est-ce que les mots changent, ne cesse-t-on aujourd’hui de se demander, face au rouleau compresseur américain ? Absolument tout. On parle beaucoup de rapport de force — comme si la force ne s’exprimait que par les moyens.
Mais Saint-Pierre-et-Miquelon rappelle une vérité plus élémentaire : la première puissance est grammaticale. Elle consiste à nommer la ligne rouge, à la rendre intelligible, à l’énoncer de manière irrévocable.
De Gaulle ne « gagne » pas parce qu’il est plus fort ; il gagne parce qu’il refuse de parler comme un obligé. C’est précisément au moment où il est le plus faible qu’il se montre le plus digne et le plus droit.
Deuxième leçon : la métonymie comme stratégie de puissance.
Sur le papier, Saint-Pierre-et-Miquelon n’est pas un objectif militaire majeur. Mais dans les têtes, c’est un symbole.
Pour la France libre, être reconnue et administrer des territoires n’est pas accessoire : c’est la condition pour être un gouvernement et non un simple « mouvement », et donc pour rester audible auprès des Français. Dans cette logique, reprendre un fragment minuscule, c’est rouvrir l’imaginaire du possible : si l’on peut reprendre Saint-Pierre, alors la reconquête de la France n’est plus une abstraction.
Dans sa recension des événements 13, Muselier justifiera la prise de Saint-Pierre-et-Miquelon par deux éléments : « le vent d’espoir qui secouerait la France » et « la valeur de propagande mondiale d’une telle action ». Une partie pour le tout : la preuve par la carte.
Troisième leçon : parler la langue de l’adversaire — et retourner ses mots contre lui.
Dans un espace atlantique dominé par le mot « democracy », Muselier utilise le référendum comme une arme diplomatique — et la mise en scène démocratique sert de piège moral tendu à l’allié.
L’annonce des résultats (98 % des suffrages exprimés pour la France libre) produit une séquence très puissante : l’acte militaire est immédiatement recodé en acte de souveraineté populaire.
Pour les États-Unis, revenir en arrière ne serait plus seulement « rétablir le statu quo », ce serait défaire un vote. La diplomatie se retrouve désarmée par le langage même qu’elle prétend incarner.
La leçon vaut pour aujourd’hui.
Si l’actuel pouvoir américain se raconte dans la rhétorique de la « paix », de l’« arrêt des guerres », jusqu’au fantasme du prix Nobel brandi comme horizon personnel, alors c’est peut-être sur ce terrain symbolique qu’il faut l’entraîner, peut-être, le repousser jusqu’à une limite : le contraindre et l’obliger à choisir entre son récit et ses actes, entre l’image qu’il vend et la réalité qu’il produit.
Sources
Curzio Malaparte, Technique du coup d’État, Paris, Grasset, 1931 (2022).
Cité dans Raoul Aglion, L’Épopée de la France combattante, New York, Éditions de la Maison française, 1943.
« Le ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France libre », Collection « Mémoire et Citoyenneté » n°21, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, Ministère des Armées.
Cité dans William Hanna, « La prise de Saint-Pierre-et-Miquelon par les forces de la France libre : Noël 1941 », Revue d’histoire de l’Amérique française, Volume 16, n°3, décembre 1962.
Ibid.
Charles de Gaulle, Mémoires de guerre – Tome 1, L’Appel, Paris, Plon, 1964.
Ira Wolfert, « Take Vichy Colony », The New York Times, 25 décembre 1941.
Robert Aron, Grands dossiers de l’histoire contemporaine, Paris, Librairie Académique Perrin, 1964.
Dans ses propres Mémoires, publiés en 1948, Cordell Hull justifie sa position vis-à-vis de Vichy en expliquant que l’objectif, à l’époque, était d’user de leur influence « pour empêcher la flotte et les bases françaises de tomber aux mains des Allemands, et maintenir des observateurs en France et en Afrique du Nord ».
Freda Kirchwey, « Mr Hull should resign », The Nation, 3 janvier 1942.
Général de Gaulle, Mémoires de guerre – Tome 1, L’Appel, op. cit.
Cité dans la Revue de la France libre, n°276, 4e trimestre, 1991.
Émile Muselier, De Gaulle contre le gaullisme, Paris, Le Chêne, 1946.As a fitting narrative to follow the last, the compiler has selected the following account of the French settlement, principally written from information furnished by Mr Wæckerlie, one of the original settlers, who came in the Comte de Paris.
About the year 1820, the adventurous seamen who had hitherto captured the whale in the Northern Ocean, found that the fish were fast decreasing in number, and turned longing eyes to the vast waters of the South Pacific, which voyagers had told them swarmed not only with many varieties of the whale tribe found in the north, hut also with the huge sperm, whose oil was of great value, as well as the spermaceti found in its head. A few soon ventured, and their good reports and great success induced many to follow their example. At first the Cape of Good Hope was chosen as the centre of the operations of those daring men, whose lives were in continual peril, but whose profits we r page 86enormous; but year by year they fished further and further, and the coasts of Australia and New Zealand were soon made tbe scene of their dangerous avocation.
About 1835, before the first representative of England (Captain Hobson) had taken up his residence in Auckland, an adventurous French mariner, named Captain L'Anglois, came on a whaling cruise to these seas, Amongst the many harbours that he visited was the beautiful Bay of Akaroa, the perfect safety of whose sheltered waters went straight to the heart of the rough seaman, after the fierce gales he had encountered in the stormy southern seas. The luxuriant vegetation that everywhere fringed the inlets, showed that the soil was of exceeding fruitfulness; the mighty pines that towered above their meaner fellows gave promise of a vast supply of timber; whilst the innumerable kakas, pigeons, and other native birds, that woke the echoes of the bush with their harmonies and discords, and the fish that swarmed in the waters of the bay, showed that an abundant supply of nutritious food would always be obtainable. So charmed was Captain L'Anglois with the tranquility of the spot, that, with a true Frenchman's love of France, he coveted it for his country, and determined to found a colony on this scene of primeval loveliness. It was in the year 1838 that he first had an opportunity of taking the premier steps in this direction, by purchasing all that part of the Peninsula from the Maoris which lies between Piraki and the Akaroa Heads. Mr Wæckerlie did not know the name of the chief from whom Captain L'Anglois purchased the land, and the price paid for it, but doubtless the amount, was a comparatively small one, (See pages 80 and 81.)
In 1838 Captain L'Anglois returned to France, and on his arrival he told some of his countrymen of the purchase he had made, and the result was the formation of a company to colonize this estate. The company appears to have been encouraged by the French Government, for an old ship of war called the Comte de Paris was lent to Captain L'Anglois to take out any persons who might be desirous of settling on his land, and another armed ship, page 87the L'Aube. was sent to New Zealand beforehand, under the charge of Commodore Lavaud, to project the colonists on their arrival. All this, however, was done quietly, for the English had already settled in parts of the islands, though New Zealand was not proclaimed a British colony till 1841. It was not till the middle of the year 1839 that the company was formed, under the name of the Nantes-Bordelaise Company. The principal people taking an active part were Captain L'Anglois and his brother, M. Jacques L'Anglois, and M. M. St. Croix and Eugene de Belligny. In August, 1839, the company advertised for emigrants in Havre de Gras, offering a free passage and the occupation of five acres of land on arrival, which would become the freehold of the occupier in five years, if cultivated within that time, but if not cultivated it would revert to the company. Each emigrant was also promised provisions sufficient to last eighteen months after landing in the settlement. There does not seem to have been much enthusiasm shown, for it was the first of January, 1840, before some thirty persons left Havre in a steamer bound to Rochefort, whence the Comte de Paris was to sail for the new colony. After an eight days' passage, they arrived at Rochefort only to find that the Comte de Paris was not nearly ready for sea. On the 8th March, 1840, everything was ready for a start, A good many more emigrants had joined at Rochefort, so that at that time there were 65 on board, which, with the officers and crew, made the total number of souls on board the Comte de Paris 105. There were six Germans amongst the emigrants. M. St. Croix de Belligny, who is, it is said, living in Auckland, acted as agent for the company, and by his great affability and skill he appears to have won universal goodwill. There were no stock on board the vessel, not even so much as a cat or dog, but there were choice collections of all sorts of seeds, and a number of carefully selected grape vines.
The start was a most unfortunate one, for the steamer that towed the vessel out missed the channel, and the Comte de Paris stuck in the mud, and had to be lightened page 88of part of her cargo before she could be got off. However, on the 19th March, these difficulties were surmounted, and a fair wind soon took the vessel out of sight of France. The first part of the passage was not eventful, but was very uncomfortable, for the Comte de Paris not only sailed very slowly, but steered very badly. The weather too was very rough, and all on board were glad when a short stay was made at an island in the tropics (probably St. Helena), where fresh provisions, including a bountiful supply of bananas, were procured. Four months after starting, when off the coast of Tasmania, a terrific storm of thunder and lightning was experienced. The lightning first struck the main topgallant and topmasts, and they both carried away. The seamen were terrified at the catastrophe, and great confusion ensued. Immediately orders were given to take all sail off the mizzen mast, but fortunately they were not immediately obeyed, or there would have been great loss of life, for a second flash struck the mizzen mast, and it carried away about eight feet from the deck, and the vessel broaching to it in the trough of the sea nearly capsized. Captain L'Anglois and his crew were, however, equal to the emergency. They cut away the wreck and rigged jury masts, and a month later they were off the Peninsula. Here two of the immigrants died, and, as their friends were desirous that they should be buried on land, the vessel anchored in Pigeon Bay, where the remains of the unfortunate colonists were interred on the beach. It was a primitive burial, and all traces of the graves have long since been swept away. Captain L'Anglois was anxious before entering Akaroa Harbour to ascertain if Commodore Lavaud had arrived there, and taken possession of the place, as previously arranged, so he despatched a whaleboat from Pigeon Bay for that purpose. Four days later the boat returned with the distressing intelligence that there was no sign of the frigate. On the 14th August the Comte de Paris sailed from Pigeon Bay, and anchored at Akaroa Beads on the 15th, and despatched another boat up the harbour in search of the lagging Commodore. This time the search was successful, for page 89they found the vessel had arrived, and the frigate's launch was sent to tow the Comte de Paris up the harbour. Very lucky it was for those on board that such was the case, for there was a heavy sea running at the Heads, and one of the flukes of the anchor had broken, and the vessel had drifted close to the rocks. However, the frigate's boat soon had her in tow, and once inside the Heads all difficulties were passed, and tbe following morning found her safe anchored off the future town of Akaroa, All on board were delighted and astonished at the delightful prospect, and the colonists were determined not to spend another night on board the ship, so all the spare sails and canvas were taken ashore, tents hastily rigged, and the wearied voyagers reposed that night where the Akaroa Mail office used to stand (now the property of Mr Joseph Hammond). The morning of the 17th was calm and beautiful, and the colonists were pleasantly awakened at the first dawn of day by the notes of innumerable birds.
A strange circumstance had been noticed by the new arrivals in coming up the harbour. When the Comte de Paris was towed past Green Point, mar where Mrs. J. C. Buckland's residence now stands, all on board saw a small group of men surrounding a flagstaff, from which flew gaily in the morning breeze" the Union Jack of Old England." Such a sight naturally surprised and disturbed the new comers, but they were told it meant nothing, but was merely a piece of vain glory on the part of two or three Englishmen who happened to be whaling in the vicinity. The real facts of the case, however, were by no means so unimportant as was represented, It appears that Commodore Lavaud, on his way from England, touched at Auckland, and that whilst his vessel was lying in the calm waters of the Waitemata, Captain Hobson, who then represented British interests in the north, though New Zealand had not been made an English Colony, entertained them right royally. It appears that in an unguarded moment the Commodore let out the secret of the French expedition to Akaroa, and what was more injudicious, spoke with rapture of the beauty of Akaroa page 90the soil, and other natural advantages. Now Captain Hobson was a man of action and of foresight, He saw that New Zealand had a great future before it, and was anxious that when it was made a jewel of the British Crown, it should be without a flaw, He then called in stratagem to his aid. and whilst the gay Frenchmen were enjoying themselves ashore after their weary voyage, a small brig of war, named the Britomart, was secretly despatched under the charge of Captain Stanley, conveying Mr. Robinson, who was instructed to make the bast of his way to Akaroa, and, if possible, hoist the English flag there before the French arrived. Meanwhile, Commodore Lavaud appears to have been in no hurry to reach his destination, for he knew the sailing qualities of the Comte de Paris, and did not think she could arrive here till the end of August. Besides, the company was good, and he knew Akaroa was only a beautiful wilderness at the bast, so it was early in August before the L'Aube sailed down the east coast and passed through Cook Straits on her way to the Peninsula, Meanwhile, Mr. Robinson and hia expedition had not had a very good time of it, and it was with very desponding hearts that on the 10th August they reached Akaroa, for they feared the French must have been before them and taken possession of the place. What was their delight then to find that no foreign keel had ploughed the waters of the bay. No time was lost, the English flag was at once hoisted, and the country claimed for the British Crown on the 11th. It was not too soon, however, for four days later Commodore Lavaud arrived. But the new colonists knew nothing of this. The Commodore held a conference with Mr. Robinson, and it was agreed that whilst the French man of war remained in the harbour, the English flag should not be hoisted, and the fact of their having taken possession before the arrival of the French be kept a secret, for fear it should lead to disturbances between the English and the new comers. The secret was-well kept, and though of course many rumours were current, it was not till years afterwards that the arrivals by the Comte de Paris were aware that they were living in an English, and not a French Colony. As soon as possible after the landing on the 16th August the land was allotted to the settlers. As before stated, the bush came down almost to the water's edge in many places, so there was little clear land. It was therefore arranged to divide the land facing the sea into two and a half acre blocks, giving one to each emigrant, and to let them select their other two and a half acres where they liked, it being the condition of the tenure that the land should be cultivated within five years of the arrival, or revert to Captain L'Anglois, The colonists all avoided selecting land in the bush, but took up the clearings which they found here and there, which were then covered with toi toi. They lived altogether in the tents for about a month, but by that time they nearly all removed to the whares they had built on their respective sections. The six Germans who were amongst the emigrants found that they could not get their sections altogether in Akaroa, so they determined to explore Captain L'Anglois' estate further. They found a beautiful bay with plenty of clear land a little higher up the harbour, and asked permission of the Commodore to loca'e themselves there. Permission was granted, five acres were parcelled out for each, and the bay was christened with the name it still bearg of German Bay. The Germans built a great V hut, 40 feet by 80 feet wide of timber and rushes, with proper divisions, and in this they passed a very pleasant winter. Commodore Lavaud built a magazine in Akaroa, just where the Courthouse now stands, and this was used for the storage of provisions and tools, and also for a hospital. Everything went peacefully along, the seeds germinated well, the vines flourished, and the colonists were content with their prospects. The French settlement was, of course, under, French law, which was administered by Commodore Lavaud. Mr. Robinson was the English Resident Magistrate, but this office was almost a sinecure.
À cette époque, l'Angleterre était encore liée au continent européen. Mais les lois de la nature en ont décidé autrement... Par Diane Frances avec AFP Phil Noble / Reuters
SCIENCES - Une gigantesque chute d'eau large de dizaines de kilomètres a rompu une crête rocheuse qui reliait l'Angleterre au continent européen il y a près de 500.000 ans, déclenchant une inondation catastrophique qui a creusé la Manche et créé l'île de la Grande-Bretagne, selon une étude publiée ce mardi 4 avril.
Une équipe internationale de géologues a mené un véritable travail de détective pour parvenir à assembler les morceaux d'un puzzle qui occupe leur profession depuis plus d'un siècle.
Pour leur enquête, ils sont remontés à un âge glaciaire il y a 450.000 ans, lorsqu'une grande partie de l'hémisphère nord était couverte par une dalle glacée épaisse et que le niveau de la mer était nettement plus bas qu'aujourd'hui.
À l'époque, la Manche était à sec et selon les scientifiques, elle s'élevait vers une crête rocheuse crayeuse qui reliait la Grande-Bretagne et le continent au niveau de ce qui est désormais le détroit de Douvres :
Dans un article publié dans la revue Nature Communications, les scientifiques suggèrent qu'un énorme lac, alimenté par des rivières continentales, s'est créé dans le sud de la Mer du Nord, entre le bord de la calotte glaciaire et cet escarpement rocheux présumé.
Le lac a commencé à déborder, passant au dessus de la crête rocheuse, créant une chute d'eau d'environ 32 kilomètres de large et de 100 mètres de haut et se déversant dans la vallée en dessous. La chute d'eau a érodé la crête du barrage. Celui-ci a fini par craquer et s'effondrer, provoquant une gigantesque inondation qui a creusé ce qui est devenu la Manche.
Brexit, acte 1
"La rupture de ce pont terrestre entre Douvres et Calais a été incontestablement un des événements les plus importants de l'histoire de la Grande-Bretagne, contribuant à façonner l'identité insulaire de la nation aujourd'hui encore", déclare Sanjeev Gupta, géologue à l'Imperial College London, l'un des auteurs de l'article.
"Quand cet âge de glace a pris fin et que le niveau de la mer est monté, inondant le sol de la vallée pour de bon, la Grande-Bretagne a perdu son lien physique avec le continent", dit le chercheur. "Sans cet épisode dramatique, la Grande-Bretagne ferait encore partie de l'Europe. C'était le Brexit 1.0 - un Brexit pour lequel personne n'a voté."
L'hypothèse selon laquelle un lac glaciaire est à l'origine de la formation de la Manche a été avancée il y a déjà un siècle. L'étude apporte de nouveaux éléments en faveur de cette thèse.
L'un des principaux indices réside dans d'étranges trous géants découverts dans le lit de la Manche. Remplis de graviers et de sable, ils peuvent faire plusieurs kilomètres de diamètre et environ 100 mètres de profondeur. Ils ont été trouvés par hasard dans les années 1960 et 1970 lorsque les ingénieurs foraient le fond de la mer pour préparer la construction du tunnel sous la Manche.
Coup du sort géologique
Les sédiments dans ces trous étaient si meubles que les ingénieurs ont dû changer le tracé du tunnel pour les éviter. Les scientifiques pensent qu'il s'agit de bassins de plongée qui se forment sous les chutes d'eau. Ces trous peuvent devenir si gros que la falaise d'où tombent les chutes d'eau, finit par devenir instable et s'effondrer.
En utilisant un sonar et une technique permettant d'obtenir des informations sur les structures du sous-sol, les chercheurs ont découvert que sept de ces trous géants formaient une ligne droite remarquable, allant du port de Calais à celui de Douvres - le bord de la fameuse crête présumée. Ils ont également découvert des preuves d'une ancienne vallée géante sur le fond marin, signes d'une inondation massive.
Le "Brexit 1.0" s'est fait en deux temps. Il y a d'abord eu une rupture dans la barrière rocheuse puis un deuxième grand événement, plus tard, probablement causé par un déversement d'autres lacs plus petits, selon l'étude. Sans ce coup du sort géologique, la Grande-Bretagne serait restée attachée au continent, un peu comme le Danemark.
Petite mise au point avant de croire aux slogans : Il y a des expressions qui font du bien aux oreilles comme cloud souverain, hébergement européen, conforme au RGPD, données sous contrôle. La protection des données ne dépend ni des slogans, ni des frontières, mais du droit auquel obéit l’opérateur qui les exploite.
On retrouve ces slogans dans les plaquettes commerciales, les discours institutionnels, et parfois même dans des décisions publiques engageant des millions d’euros. Ils donnent l’impression rassurante que, cette fois-ci c’est bon, les données européennes sont enfin chez elles.
Un rapport juridique approfondi de l’Université de Cologne https://fragdenstaat.de/dokumente/273689-rechtsgutachten-zur-us-rechtslage_geschwaerzt/ , commandé par l’État allemand, vient rappeler une réalité beaucoup moins confortable : la protection des données ne dépend ni des slogans, ni des frontières, mais du droit auquel obéit l’opérateur qui les exploite. Et paf, que la force du Cloud Act https://fr.wikipedia.org/wiki/CLOUD_Act soit avec toi (ou pas).
Une précision indispensable (et trop souvent oubliée)
Avant d’aller plus loin, une clarification s’impose : Utiliser une technologie américaine n’implique pas automatiquement une soumission au droit américain. Une entreprise française ou européenne sans lien capitalistique avec les États-Unis, sans contrat d’exploitation avec une société américaine, exploitant elle-même son infrastructure locale, n’est pas concernée par les lois américaines, même si elle utilise un logiciel développé aux États-Unis.
Ce point est fondamental et le rapport ne dit jamais le contraire.
La question n’est donc pas quelle technologie est utilisée, mais qui exploite, administre et contrôle réellement les données.
Quand le droit américain entre en salle serveur
Le rapport est très clair : les autorités américaines disposent de plusieurs cadres juridiques leur permettant d’accéder à des données lorsqu’elles sont sous le contrôle d’une entité soumise au droit américain.
Et ce contrôle peut exister même si les serveurs sont en Europe, les clients sont européens, les contrats sont signés avec une filiale locale.
Ce qui compte, ce n’est pas la géographie, mais la capacité juridique ou technique de produire les données sur injonction.
Cloud public ou cloud privé, juridiquement ça ne change rien
C’est souvent là que la confusion commence. Le terme cloud privé décrit une architecture technique (environnement dédié, non mutualisé, isolé d’autres clients) mais juridiquement, ce terme n’a aucune valeur.
Si l’infrastructure est exploitée, administrée, maintenue ou contrôlée par une entreprise soumise au droit américain, alors les données peuvent être légalement exigées par les autorités américaines, indépendamment du qualificatif “privé”, “dédié” ou “isolé”.
Le rapport insiste sur la notion de “contrôle” (point constant du droit américain) qui est interprétée de manière large.
Un opérateur qui peut intervenir, ordonner une extraction ou être contraint de le faire est considéré comme ayant le contrôle.
Le RGPD face au droit américain (deux logiques incompatibles)
L’Union Européenne dispose d’un cadre solide de protection des données (sur le papier). Mais le rapport rappelle un fait juridique majeur : la Cour de justice de l’Union européenne a déjà annulé deux accords successifs encadrant les transferts de données avec les États-Unis.
Pourquoi ?
Parce que le droit américain autorise une surveillance étendue des personnes non américaines, sans garanties équivalentes aux droits fondamentaux européens. Et malgré ces décisions, les mécanismes de collecte persistent, les possibilités de recours restent très limitées, et les entreprises européennes ne peuvent pas réellement s’opposer à une injonction américaine.
Le RGPD protège… jusqu’à ce qu’il rencontre une loi étrangère plus impérative.
La surveillance sans fournisseur reste le point aveugle
Le rapport de l'université de Cologne évoque également un aspect rarement abordé publiquement : la surveillance sans passer par les fournisseurs cloud.
Les services de renseignement américains disposent d’un cadre juridique leur permettant d’intercepter des communications directement sur les infrastructures réseau internationales, sans coopération des opérateurs et sans notification des personnes concernées.
Ici, le débat sur le cloud devient presque secondaire. Les données circulent et peuvent être captées.
C’est opaque pour les citoyens européens mais légal aux États-Unis.
« Il suffit de chiffrer ! » (une belle illusion confortable)
Autre idée largement répandue : le chiffrement serait un rempart absolu.
Le rapport est beaucoup plus nuancé...
Le chiffrement protège contre le piratage ou l’accès non autorisé mais il ne protège pas contre une obligation légale de coopération, une injonction judiciaire ou des obligations de conservation de preuves.
Un opérateur qui s’organiserait volontairement pour ne pas pouvoir répondre à une injonction s’expose à des sanctions lourdes en droit américain.
Le chiffrement est une mesure de sécurité, pas une immunité juridique.
EUCS, SecNumCloud vu par la CNIL (Quand la souveraineté devient (enfin) un critère juridique)
Le rapport de l’Université de Cologne analyse le problème du point de vue du droit américain, la CNIL quant à elle apporte la lecture française et européenne. Et les deux convergent.
La CNIL souligne que le projet de certification européenne EUCS ne garantit plus l’« immunité juridique » vis-à-vis des lois extra-européennes, ne permet donc pas de sécuriser juridiquement les données les plus sensibles et crée une ambiguïté dangereuse pour les acteurs publics et privés.
Cette lacune est d’autant plus problématique que l’État français promeut une doctrine dite « Cloud au centre », tout en exigeant que les données d’une sensibilité particulière ne soient pas exposées à des lois étrangères et que la loi SREN (du 21 mai 2024) impose désormais explicitement cette protection contre les accès non autorisés par des États tiers.
Autrement dit, une certification européenne peut être conforme sur le papier, tout en étant juridiquement insuffisante dans les faits.
La CNIL le dit sans détour :
sans critères d’immunité face aux lois extra-européennes, le cloud certifié EUCS ne peut pas accueillir les traitements les plus sensibles.
Mais ça change quoi concrètement ?
Pour un particulier : Les données professionnelles, administratives ou personnelles hébergées chez un opérateur soumis au droit américain peuvent être accessibles sans information préalable, sans recours direct, et sans ciblage individuel. Vous n’êtes donc pas visé personnellement, mais vos données peuvent être collectées dans des ensembles plus larges.
Pour une PME : Une PME utilisant un service opéré par une entreprise américaine reste responsable au regard du RGPD, sans maîtriser les décisions juridiques prises à l’étranger ni être informée d’une éventuelle réquisition. Le risque juridique est assumé localement, pour une décision qui échappe au client.
Pour une collectivité ou une administration : Là, ça se complique et la situation devient critique... Données sociales, scolaires, de santé, d’état civil : si l’opérateur final dépend du droit américain, le risque n’est plus théorique, même avec des infrastructures dédiées et des contrats européens. En cas de problème, la responsabilité retombera sur la collectivité (et paf, on vous envoie GI-Joe).
Conclusion : la souveraineté ne se décrète pas !
Ce rapport ne dit pas que « tout cloud américain est dangereux », il dit quelque chose de plus précis et plus dérangeant : La souveraineté des données dépend du droit auquel obéit l’exploitant, pas du discours commercial.
Utiliser une technologie américaine n’est pas un problème mais dépendre juridiquement d’un opérateur soumis au droit américain en est un.
La souveraineté numérique n’est ni un label, ni un mot rassurant, c’est une chaîne de contrôle juridique.
Et tant que cette chaîne traverse l’Atlantique, les données européennes voyageront avec elle. Vous êtes prévenus ;)
Sources :
Heise Online https://www.heise.de/en/news/Opinion-US-Authorities-Have-Far-Reaching-Access-to-European-Cloud-Data-11111060.html
FragdenStaat https://fragdenstaat.de/dokumente/273689-rechtsgutachten-zur-us-rechtslage_geschwaerzt/
CNIL https://www.cnil.fr/fr/cloud-les-risques-dune-certification-europeenne-permettant-lacces-des-autorites-etrangeres
Le mot de Kat : ça sent le vécu, là...
Il y a quelques années, on notait un film sur Allociné, un aspirateur sur Amazon, et basta. Aujourd’hui, on note tout. Absolument tout. Ton resto, ton coiffeur, ton garagiste, ton médecin, ton kiné, ton ostéo, ton livreur… ta propre existence bientôt ?
“Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous votre réveil ce matin ?” Bienvenue dans le monde merveilleux où Google & Co. transforment chaque geste du quotidien en enquête de satisfaction.
Vous avez remarqué ? On ne voit plus les routes sur Google Maps. On voit des icônes. Restaurants, hôtels, spas, garages, boulangeries, toiletteurs pour chiens, toiletteurs pour humains, bars à vin, bars à bière, bars à chats, bars à chutistes (:-))…
Tu veux juste aller à Ikéa pour acheter une étagère en carton recyclé compressé bio (celle qui s'autodétruit quand on la monte). Tu demandais autrefois ton chemin. Maintenant, tu reçois :
un mail “Merci d’avoir visité Ikéa” alors que t'es encore sur le parking,
une notification “Avez-vous apprécié votre expérience d’achat ?”,
et parfois même “Souhaitez-vous devenir Local Guide niveau 147 ?” Local Guide... Le seul programme au monde où on te transforme en employé bénévole qui bosse pour Google sans salaire, sans RTT, sans tickets resto et sans retraite. Juste pour avoir un badge numérique qui brille quand tu regardes ton écran avec suffisamment de culpabilité.
L’hôpital ? Un 5 étoiles… ou pas
Alors celle-là, elle est croustillante.
Tu sors du bloc opératoire, t'es encore dans le jazz. Ton cerveau flotte au-dessus de la table d’opération, ton âme est partie acheter des pains au chocolat à la cafétéria en bas.
Et ding ding :
“Évaluez votre chirurgien de 1 à 10.”
EXCUSE-MOI GOOGLE MAIS JE NE SUIS PAS SÛR QUE JE SOIS VRAIMENT EN ÉTAT D’ÉVALUER QUI QUE CE SOIT ... LÀ TOUT DE SUITE MAINTENANT !
Bientôt une alerte pendant l’anesthésie ?
“Sur une échelle de 1 à 5 étoiles, comment jugez-vous notre protocole d'endormissement ?”
“...zzzzzz”
“Merci ! Votre avis compte !” Le labo, la pharmacie, le podologue…
Tu vas faire une prise de sang et deux minutes plus tard, sur le trottoir, ding ding :
“Comment avez-vous trouvé les prestations du laboratoire bidule ?”Bah… j’en sais rien ? Je viens littéralement tout juste de sortir, j’ai encore un pansement au creux du coude et j’ai pas bu mon café. Laissez-moi trois minutes pour redevenir un être humain, s’il vous plaît.
Et maintenant, les appels ?
Ton téléphone sonne : numéro inconnu. Tu décroches ou pas ? Trop tard, Google te demande :
“Ce correspondant est-il un professionnel ?”Un jour, un inconnu va appeler pour te dire “Bonjour, c’est pour une enquête de satisfaction”, et Google demandera derrière :
“Êtes-vous satisfait de cet appel de satisfaction ?”On n’en sortira jamais.
Mais alors… comment ça marche, ce cirque ?
Mystère. Google ne communique évidemment pas très précisément sur le “comment”, mais les pistes sont connues :
-
GPS + comportements = devinette “intelligente” Tu entres dans un commerce -> ton téléphone capte l’adresse -> Google suppose que tu étais un client -> paf, enquête.
-
Analyse des mails sous Gmail Tu reçois une facture, un bon de commande, un ticket, une confirmation de rendez-vous -> Google sait que tu as consommé un service -> paf, enquête.
-
Les pros paient Google Business Les entreprises peuvent activer (ou laisser activé par défaut) des options d’évaluation automatiques. Beaucoup ne savent même pas que le truc est activé par défaut. Les secrétaires pensent que ça vient de Google. Les directeurs pensent que ça vient du groupe. La vérité ? Ça vient d’un capitalisme dopé à la donnée qui veut tout noter pour tout vendre à tout le monde (et si possible te faire bosser gratos).
- Le modèle économique du futur : l’évaluation permanente Pourquoi ? Parce que les avis c'est l'or du web. Parce que les commentaires ce sont des données importantes. Parce que ta fatigue numérique c'est le carburant du modèle publicitaire.
Jusqu'où ça ira ?
Évaluer une prise de sang ? OK. Évaluer un vendeur ? Bon. Évaluer un chirurgien alors que tu dors encore ? On frôle déjà le surréalisme (ou la connerie) !
Alors imaginons la suite…
“Veuillez évaluer votre passage aux toilettes publiques.”
“Avez-vous apprécié ce feu rouge ?”
“Notez votre conversation avec votre belle-mère.” (laissez vos émotions prendre le dessus)
“Sur une échelle de 1 à 5, comment trouvez-vous votre propre comportement aujourd’hui ?”
Le futur appartient à ceux qui cliquent tôt.
le monde devient un gigantesque formulaire Google
On ne vit plus. On ne fait plus. On évalue.
On note tout, tout le temps, partout. Et si on résiste, on reçoit un rappel :
“Votre avis est important pour nous.”Non, Google. Ce qui est important pour toi, ce n’est pas mon avis. C’est mes données.
Mercredi, le service des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis (CBP), a publié un document listant les mises à jour qu’il préconise en termes de collecte de données pour la délivrance des autorisations de voyage électroniques (ESTA). Sous couvert de protéger le pays « contre les terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale », les touristes devront bientôt livrer à l’administration Trump des informations personnelles que même leur propre gouvernement ne possède pas.
Les ressortissants de certains pays, dont la France, n’ont pas besoin d’un visa pour se rendre aux Etats-Unis s’ils comptent y faire du tourisme pendant moins de 90 jours et qu’ils possèdent un passeport biométrique. Il suffit de remplir une demande d’ESTA en ligne en répondant à quelques questions normales, du genre adresse, téléphone, contact en cas d’urgence, voire nom et adresse de l’employeur. Une question a été ajoutée en 2016, demandant des « renseignements associés à votre présence en ligne » tels que les « identifiants aux médias sociaux ». La question est « marquée comme optionnelle », et l’absence de réponse n’empêche pas la prise en compte de la demande d’ESTA.
Les États-Unis en quête de touristes bienveillants
Ça et plein d’autres choses vont changer début 2026. Le CBP a ainsi pondu un projet élargissant les données collectées pour obtenir un ESTA ou un visa, expliquant que l’idée est de se « conformer au décret présidentiel 14161 de janvier 2025 ». Le décret censé « protéger les États-Unis contre les terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale et à la sécurité publique », a des visées plus larges et permet bien des libertés à l’administration Trump. En gros, outre vérifier que vous n’êtes pas un terroriste, les États-Unis vont s’assurer que vous n’avez « pas d’attitude hostile envers leurs citoyens, leur culture, leur gouvernement, leurs institutions ou leurs principes fondateurs ».
Pour cela, le CBP va se montrer beaucoup plus intrusif qu’il ne l’est déjà, en commençant par abandonner le site web servant à déposer les demandes d’ESTA au profit d’une application mobile. La raison ? Elle « offre des méthodes de vérification d’identité avancées, notamment la détection de présence, la reconnaissance faciale et la vérification de la puce électronique du passeport par la technologie NFC ».
Ensuite, les demandeurs d’ESTA devront désormais obligatoirement « fournir leurs profils sur les réseaux sociaux des cinq dernières années ». Par « profils », le CBP entend « identifiants » et non pas un historique détaillé de tout ce qui a été publié. Mais cela implique de livrer une liste exhaustive des comptes sur 5 ans, qu’ils soient actif ou non. En revanche, l’administration américaine n’a pas encore précisé ce qu’elle entend par « médias sociaux ».
Des données sur les cinq à dix dernières années
Mais il y a encore pire en termes de données privées. Aux données « de base » collectées, le CBP souhaite ajouter ce qu’il appelle des « champs de données à forte valeur ajoutée ». Il y en a onze en tout, et les défenseurs du RGPD vont y laisser leurs derniers cheveux en voyant cela. Entre autres, il y a les numéros de téléphone utilisés au cours des cinq dernières années, mails utilisés au cours des dix dernières années, noms des membres de la famille et leurs numéros de téléphone sur les cinq dernières années, dates, lieux de naissance et adresses des membres de la famille, biométrie complète, empreintes digitales, ADN, numéros de téléphone professionnels sur les cinq dernières années et adresses mail professionnelles sur les dix dernières années.
Démocratie oblige, le CBP doit soumettre tout ça « au Bureau de la gestion et du budget pour examen et approbation ». Le public et les « autres agences fédérales » sont aussi invités à donner leur avis sur ces nouvelles mesures, « au plus tard le 9 février 2026 ». On ignore toutefois si ces avis auront vocation à modifier le contenu du texte ou s’ils sont purement consultatifs.
Après dix mois à chambouler la vie de centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux, de millions d'Américains anonymes et de millions d'autres dans le monde entier, le département de l'Efficacité gouvernementale ou DOGE, semble avoir vécu.
Selon un article de Reuters paru le 23 novembre, Scott Kupor, le directeur de l'Office of Personnel Management (OPM), le service des ressources humaines de la fonction publique états-unienne, a fait une révélation intéressante. Interrogé par l'agence de presse sur le statut du DOGE, Scott Kupor a répondu: «Ça n'existe pas.» Il a ensuite précisé dans une publication sur le réseau social X que si le DOGE «n'avait peut-être pas de direction centralisée», ses principes «restent tout à fait d'actualité» au sein de l'administration Trump. Mais cette distinction ne rend pas le DOGE moins mort pour autant.
Voici donc une fin en eau de boudin pour un épisode de destruction pure, fomenté par l'homme le plus riche du monde, qui s'était vu remettre les clés du gouvernement des États-Unis afin qu'il en dispose selon son bon plaisir. Et c'est un Elon Musk au cerveau possiblement embrumé par la drogue qui s'est chargé de la branche exécutive du gouvernement avec toute la diligence d'un gamin de 5 ans qui s'occupe d'une Barbie: une coupe de cheveux tragique par-ci, un grand coup de marqueur indélébile par-là, avant de l'abandonner une ou deux semaines au fond du panier du chien.
Pour Elon Musk et les employés du DOGE qui se sont chargés de cette impitoyable attaque en règle du travail des agences fédérales, cela a été une exaltante foire d'empoigne dans les sphères du pouvoir. Pour le reste de la population, cela a été une catastrophe dont les conséquences vont se faire sentir sur plusieurs générations.
Un échec évident, selon la cinglante réalité des chiffres
Selon ses propres critères (réduction des dépenses et du gaspillage), le DOGE est un échec cuisant. Lorsqu'Elon Musk a été désigné pour diriger ce ministère fondé à la hâte après l'élection de Donald Trump, en novembre 2024, il s'est engagé à réduire les dépenses fédérales de 2.000 milliards de dollars la première année. Le 9 janvier 2025, avant même que Donald Trump ne prenne ses fonctions onze jours plus tard, Elon Musk avait réduit ses ambitions de moitié et estimé les futures coupes budgétaires à 1.000 milliards de dollars. Au bout de quelques mois, le chiffre promis avait encore diminué et tournait autour de 150 milliards de dollars.
Chaque fois que le département de l'Efficacité gouvernementale a voulu afficher ses réussites, ses chiffres n'ont pas résisté à un examen approfondi. Cet été, lorsque le DOGE a annoncé avoir fait économiser 52,8 milliards de dollars aux États-Unis, en mettant un terme à des contrats gouvernementaux, le média Politico n'a pu vérifier que pour 32,7 milliards de dollars de contrats effectivement résiliés et a conclu à une économie totale de seulement 1,4 milliard de dollars.
Le DOGE est arrivé à son estimation en usant d'une comptabilité fallacieuse. Selon Jessica Tillipman, doyenne associée aux études de droit des marchés publics au sein de la faculté de droit de l'université George-Washington (Washington D.C.), le stratagème utilisé reviendrait à «prendre une carte de crédit avec un plafond de 20.000 dollars, annuler le contrat et clamer ensuite: “Je viens d'économiser 20.000 dollars.”» Dans un des cas, le DOGE a affirmé avoir fait économiser 8 milliards de dollars aux contribuables états-uniens en annulant un contrat d'une valeur maximale de 8 millions de dollars.
Le funeste sort de l'Usaid... et des personnes qui bénéficiaient de son budget
Malgré toutes ses victorieuses exagérations, le DOGE a réellement battu des records, mais plutôt du côté des pertes. En première place sur la liste, figure la dissolution de l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid). En tant que projet du gouvernement américain, l'Usaid n'était pas seulement un instrument de diplomatie opérant en douceur, c'était aussi une des initiatives les plus rentables en matière de progrès pour l'humanité. Sur les 15.000 dollars d'impôts payés en moyenne par chaque Américain·e en 2024, seuls 24 dollars étaient redirigés vers l'Usaid. Le budget de l'agence lui a permis de sauver 92 millions de vies dans le monde entier en deux décennies.
En faisant de la suppression de l'Usaid une de ses toutes premières décisions, le DOGE envoyait un message au monde entier: ces vies ne comptent pas autant que les vies américaines blanches et chrétiennes, privilégiées par l'administration Trump. C'était une manière de marquer des points politiques en malmenant les méprisables indigents du reste de la planète, en même temps qu'une salve inaugurale dans la guerre d'Elon Musk contre les andouilles qui croient bêtement en une gouvernance bienveillante et réfléchie au service d'un monde meilleur.
La suppression de l'Usaid a déjà porté ses funestes fruits. Selon une étude conduite par l'épidémiologiste Brooke Nichols de l'université de Boston (Massachusetts), plus de 654.000 personnes sont pour l'heure mortes à cause de la fin de l'aide apportée par l'Usaid, dont plus de deux tiers sont des enfants. Même si une partie des financements est restaurée, ce bilan des morts liés au DOGE continuera de croître, car il faut parfois du temps pour que des personnes meurent de maladies soignables et évitables qui n'ont été ni traitées ni évitées. Et chaque mort par la faute de l'équipe muskienne de programmateurs naziphiles et d'un racisme éhonté laissera derrière elle des proches dévastés par le chagrin.
Le reflet décomplexé de la politique de Donald Trump
Cet allègre dédain pour la vie des pauvres racisés n'est qu'une des illustrations de la manière dont le DOGE est un parfait miroir du projet de Donald Trump et résume à lui seul toute son administration. Il y a aussi eu le mépris du DOGE pour la loi (en septembre, un tribunal fédéral a jugé que des dizaines de milliers de licenciements étaient illégaux) et son impunité (le juge n'a pas ordonné que les salariés soient réengagés).
Il y a eu sa manière de tenter de compliquer la vie des Américains ordinaires tout en aidant les banquiers fortunés (en réintroduisant les frais de découvert); ainsi que celle qui a nui aux malades (en mettant abruptement un terme à des centaines d'essais médicaux auxquels participaient plus de 74.000 patients). Le DOGE a aussi été le principal instrument de mise en place de la stratégie de Donald Trump qui consiste à faire tellement de choses choquantes et inadmissibles qu'il en est devenu impossible de se concentrer sur une transgression en particulier.
Associant la mentalité bâclée et aventurière d'une start-up de la tech et l'indifférence morale de mercenaires du piratage, le DOGE a fini par devenir le prétexte d'une nouvelle attaque contre le peuple états-unien.
Le DOGE, tout comme le reste de l'administration Trump, est une illustration de ce qui se produit lorsque les gens les plus ignorants, les plus négligents et avec les moins bonnes intentions du monde sont placés aux manettes pour prendre des décisions sur des questions de vie ou de mort. Des ingénieurs logiciels âgés d'une petite vingtaine d'années ont été investis de l'autorité d'annuler personnellement des versements à des programmes jugés critiques par le secrétaire d'État Marco Rubio, tels que l'aide à l'Ukraine ou à la Syrie, ainsi que des initiatives du Plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le sida (Pepfar) qui vise à combattre le VIH en Afrique.
Les employés du DOGE ont été à l'initiative du renvoi de milliers d'agents de l'Internal Revenue Service, l'agence gouvernementale chargée des impôts, avant de se rendre compte de leur importance et de supplier qu'ils soient réintégrés. Des gens comme un certain Edward Coristine, alias «Big Balls» («grosses couilles» en français), âgé de 19 ans et arrivé au sein du DOGE avec un passif de fuite de données sensibles d'un précédent employeur, se sont soudain mis à décider de la poursuite de la recherche sur le cancer, de la pertinence du secours à apporter aux randonneurs égarés dans les parcs nationaux et de l'aide humanitaire à expédier après une catastrophe naturelle.
Associant la mentalité bâclée et aventurière d'une start-up de la tech et l'indifférence morale de mercenaires du piratage, le DOGE a fini par devenir le prétexte d'une nouvelle attaque contre le peuple états-unien. Au début du mois d'août, lorsqu'Edward «Big Balls» Coristine a été agressé par au moins deux autres adolescents à 3h du matin, dans un quartier de Washington, Donald Trump a pris cet événement comme un prétexte pour envoyer la garde nationale patrouiller dans la capitale, le début d'une «vague» d'opérations policières fédérales dans tout le pays.
Le 47e président des États-Unis n'avait pas besoin d'une raison pour justifier de punir les villes démocrates. Mais il était logique que l'incident qui lui a servi à lancer son occupation de Washington implique le type qui avait ravagé le principal employeur de la ville.
Le lent poison du DOGE n'a pas fini d'intoxiquer les États-Unis
L'administration Trump a récusé l'annonce de la mort du département de l'Efficacité gouvernementale par Reuters. Scott Kupor, le directeur du service des ressources humaines de la fonction publique, a insisté sur le fait que l'esprit du DOGE persisterait. Il a écrit sur X que les agences fédérales allaient désormais «institutionnaliser» les initiatives de réduction des réglementations et des emplois fédéraux. En gros, a dit l'administration Trump, elle n'a pas du tout fait euthanasier le DOGE, elle l'a envoyé vivre dans un chouette refuge à la campagne.
Mais le souvenir du DOGE subsistera longtemps après le départ (un jour? peut-être?) de Donald Trump de la Maison-Blanche. Nous n'en sommes qu'au début des effets des entraves du DOGE envers le travail du gouvernement fédéral, au point que la population états-unienne va finir par perdre toute foi dans sa capacité à accomplir les tâches et les services qu'elle attend de lui depuis si longtemps. Si les États-Unis veulent un jour reconstruire le gouvernement, il leur faudra un ingrédient bien plus compliqué à trouver que du temps ou de l'argent: une volonté politique.
Les futurs dirigeants qui voudront restaurer le gouvernement tel qu'il était se verront accuser d'engorger les agences fédérales avec des milliers de «nouveaux» emplois et programmes. L'équivalent de milliers d'années de compétences cumulées auront disparu en fumée. Il sera impossible de rattraper les années volées par le DOGE dans les domaines de la recherche biomédicale, des études sur les droits civiques et du contrôle de la sécurité nationale.
Le DOGE a également laissé derrière lui une mine cachée prête à exploser à tout moment. Ce ministère avait un accès dont on ne mesure pas l'ampleur à des kilomètres de données sensibles du type renseignements financiers, dossiers médicaux et peut-être informations syndicales. Personne ne sait exactement quelles informations ont été prises ou copiées par les salariés du DOGE, où ils les ont stockées ou ce que Elon Musk a l'intention de faire avec. Ils ont dissimulé ce qu'ils faisaient et les données qu'ils piquaient en désinstallant les outils de surveillance et en effaçant les enregistrements d'accès –exactement ce que ferait une entreprise criminelle de piratage informatique.
Quiconque est assez fou pour confier la manne des données du gouvernement fédéral à Elon Musk, à «Big Balls» et à leurs acolytes, sans penser qu'ils vont les faire fuiter, les vendre, les exploiter, les échanger ou s'en servir dans leur intérêt personnel, est un crétin. C'est peut-être la fin de la courte et répugnante vie du DOGE, mais son héritage, plus sombre encore, n'a pas fini de hanter les États-Unis.
Donald Trump mène désormais sa bataille contre le « wokisme » sur le terrain lexical. « Immigrant », « santé mentale », « égalité d'accès aux soins »... La liste des mots à « éviter » dans les documents gouvernementaux s'allonge, et avec elle, l'objectif de chasser l'idéologie « woke » des agences de l'État. Le New York Times en a compilé 200 d'entre eux – la liste est probablement plus longue – issus de directives envoyées à des agences d'État pour se conformer aux décrets pris par Donald Trump. Dans les jours qui ont suivi, des mots comme « changement climatique », « discrimination » ou « LGBTQ » ont progressivement disparu des sites web de l'administration américaine, toujours selon le New York Times, captures d'écran avant-après à l'appui.
En février dernier, la Fondation nationale pour la science (NSF) – un organisme de financement de la recherche scientifique américaine – a envoyé aux chercheurs un document interne listant plus de 120 mots « à bannir » de leurs demandes de subvention mais aussi de la présentation de milliers de projets en cours. La raison ? L'emploi d'un de ces mots « suspects » déclenche automatiquement une inspection de l'administration pour déterminer s'ils respectent bien les nouveaux décrets et le cas échéant décréter l'arrêt pur et simple de leur financement.
Voici la liste des mots recensés par le New York Times le 7 mars, que « Marianne » a traduite pour vous.
« A » comme « antiracisme »
Accessible : accessible
Activism : activisme
Activists : activistes
Advocacy : plaidoyer
Advocate : militant, défenseur
Advocates : militants, défenseurs
Affirming care : soin d'affirmation de genre
All-inclusive : tout inclus
Allyship : allié, alliance
Anti-racism : antiracisme
Antiracist : antiraciste
Assigned at birth : assigné à la naissance
Assigned female at birth : assigné au sexe féminin à la naissance
Assigned male at birth : assigné au sexe masculin à la naissance
At risk : à risque
« B » comme « Black »
Barrier : barrière
Barriers : barrières
Belong : appartenir
Bias : biais
Biased : biaisé
Biased toward : biaisé en faveur de
Biases : biais
Biases towards : préjugés à l'égard de
Biologically female : biologiquement femme
Biologically male : biologiquement homme
BIPOC (Black, indigenous and people of color) : Noirs, autochtones et personnes de couleur
Black : noir
Breastfeed people : personne qui allaite
Breastfeed person : personne qui allaite
« C » comme « changement climatique »
Chestfeed people : personne qui allaite
Chestfeed person : personne qui allaite
Clean energy : énergie propre
Climate change : changement climatique
Climate science : science du climat
Commercial sex worker : travailleuse du sexe
Community diversity : diversité
Community equity : équité communautaire
Confirmation bias : biais de confirmation
Cultural competence : pertinence culturelle
Cuiltural differences : différences culturelles
Cultural heritage : héritage culturel
Cultural sensitivity : sensibilité culturelle
Culturally appropriate : culturellement approprié
Culturally responsive : culturellement approprié
« D » comme « discrimination »
DEI (Diversity, Equity and Inclusion) : programmes de diversité et d'inclusion du gouvernement fédéral
DEIA (Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility) : programmes de diversité, d'équité, d'inclusion et d'accessibilité
DEIAB (Diversity, Equity, Inclusion, Accessibility and Belonging) : programmes de diversité, d'équité, d'inclusion, d'accessibilité et d'appartenance
DEIJ (Diversity, Equality, Inclusion, Justice) : diversité, égalité, inclusion, justice
Disabilities : handicap
Disability : handicap
Discriminated : discriminé
Discrimination : discrimination
Discriminatory : discriminatoire
Disparity : disparité
Diverse : divers, varié
Diverse backgrounds : diversité des origines
Diverse communities : diversité des communautés
Diverse community : communauté hétérogène
Diverse group : groupe hétérogène
Diverse groups : groupes divers
Diversified : diversifié
Diversify : diversifier
Diversifying : diversification
Diversity : diversité
« E » comme « expression »
Enhance the diversity : renforcer la diversité
Enhancing diversity : renforcer la diversité
Environmental quality : qualité environnementale
Equal opportunity : égalité des chances
Equality : égalité
Equitable : équitable
Equitableness : équité
Equity : équité
Ethnicity : origine ethnique
Excluded : exclu
Exclusion : exclusion
Expression : expression
« F » comme « féminisme »
Female : femme, femelle
Females : femmes, femelles
Feminism : féminisme
Fostering inclusivity : favoriser l'inclusion
« G » comme « genre »
GBV (gender based violence) : violence basée sur le genre
Gender : genre
Gender based : basé sur le genre
Gender based violence : violence basée sur le genre
Gender diversity : diversité de genre
Gender identity : identité de genre
Gender ideology : idéologie de genre
Gender-affirming care : soins de santé d'affirmation de genre
Genders : genres
Gulf of Mexico : Golfe du Mexique
« H » comme « historiquement »
Hate speech : discours haineux
Health disparity : inégalités en matière de santé
Health equity : égalité de santé
Hispanic minority : minorité hispanique
Historically : historiquement
« I » comme « inégalités »
Immigrants : migrants
Implicit bias : biais implicite
Implicit biases : biais implicites
Inclusion : inclusion
Inclusive : inclusif
Inclusive leadership : leadership inclusif
Inclusiveness : inclusion
Inclusivity : inclusivité
Increase diversity : accroître la diversité
Increase the diversity : accroître la diversité
Indigenous community : communauté autochtone
Inequalities : inégalités
Inequality : inégalité
Inequitable : inéquitable, injuste
Inequities : injustices
Inequity : injustice
Injustice : injustice
Institucional : institutionnelle
Intersectional : intersectionnel
Intersectionality : intersectionnalité
« K » comme « key groups : groupes cibles »
Key groups : groupes cibles
Key people : individus cibles
Key populations : populations cibles
« L » comme « LGBTQ »
Latinx : latinos américains
LGBT : Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres
LGBTQ : Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres et Queer
« M » comme « minorité »
Marginalize : marginaliser
Marginalized : marginalisé
Men who have sex with men (MSM) : hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes
Mental health : santé mentale
Minorities : minorités
Minority : minorité
Most risk : risque le plus élevé
MSM : hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes
Multicultural : multiculturelle
Mx : pronom non-genré
« N » comme « non binaire »
Native American : amérindien
Non-binary : non binaire
Nonbinary : non binaire
« O » comme « oppression »
Oppression : oppression
Oppressive : oppressif, oppressive
Orientation : orientation
« P » comme « politique »
People + uterus : personnes avec utérus
People-centered care : soins centrés sur les personnes
Person-centered : axé sur la personne
Person-center care : soins centrés sur la personne
Polarisation : polarisation
Politique : politique
Pollution : pollution
Pregnant people : personnes enceintes
Pregnant person : personne enceinte
Pregnant persons : gens enceints
Prejudice : préjugé
Privilege : privilège
Privileges : privilèges
Promote diversity : promouvoir la diversité
Promoting diversity : promouvant la diversité
Pronoun : pronom
Pronouns : pronoms
Prostitute : prostitué
« R » comme « racisme »
Race : race et ethnie
Race and ethnicity : race et origine ethnique
Racial : racial
Racial diversity : diversité de race
Racial identity : identité de race
Racial inequality : inégalité de race
Racial justice : justice raciale
Racially : racialement, selon la race
Racism : racisme
« S » comme « socioéconomique »
Segregation : ségrégation
Sense of belonging : sentiment d'appartenance
Sex : sexe
Sexual preferences : préférences sexuelles
Sexuality : sexualité
Social justice : justice sociale
Sociocultural : socioculturel
Socioeconomic : socioéconomique
Status : statut, position, état
Stereotype : stéréotype
Systemic : systémique
« T » comme « transgenre »
They / them : ils, elles, eux, iel
Trans : trans
Transgender : transgenre
Transsexual : transsexuel
Trauma : trauma, traumatisme
Traumatic : traumatique, traumatisant
Tribal : tribal
« U » comme « underprivileged : personnes défavorisées »
Unconscious bias : biais implicites
Underappreciated : sous-estimé
Underprivileged : personnes défavorisées
Underrepresentation : sous-représentation
Underrepresented : sous-représentés
Underserved : mal desservi
Undervalued : sous-estimé
« V » comme « victimes »
Victim : victime
Victims : victimes
Vulnerable populations : populations vulnérables
« W » comme « women : femmes »
Women : femmes
Il voulait offrir à sa mère, qui fêtait ses 50 ans, un cadeau « à la hauteur de sa vie ». En maîtrisant bien les codes, Baptiste Jeauneau a donc fait appel pour cela à l’intelligence artificielle. Âgé de 21 ans, le jeune homme a d’abord collecté des témoignages, souvenirs et photos de proches. L’IA a ensuite fait le reste, mettant en forme tous ces fragments collectés dans un récit de vie « cohérent » selon lui. La surprise semble en tout cas avoir bien fonctionné. « Ma mère a pleuré en lisant le livre, raconte-t-il. En voyant tant d’émotions, je me suis dit que cette idée devait dépasser le cadre familial. »
Voilà comment est née la toute jeune start-up My Wai, lancée il y a quelques semaines à peine par cet étudiant en master à la Rennes School of Business. Alors que l’intelligence artificielle envahit progressivement tous les champs de notre vie, le jeune autoentrepreneur entend la « mettre au service de la mémoire humaine. » Avec comme objectif de « démocratiser la biographie », qui n’est pas réservée qu’aux personnes célèbres. Car même sans être mégalo, tout le monde a une histoire qui mérite d’être racontée.
L’écrivain public pas à la portée de toutes les bourses
Pour laisser une trace comme héritage et transmettre leur histoire, certains se tournent vers des écrivains publics qui vont faire de la vie d’anonymes un roman. Mais la démarche n’est pas à la portée de toutes les bourses, l’écriture d’une biographie pouvant grimper jusqu’à 5.000 euros en fonction du temps passé. Avec les progrès de l’intelligence générative, plusieurs start-ups se sont donc ruées sur ce marché naissant des biographies et récits de vie générés à l’aide de l’IA. Comme My Wai donc, mais aussi Life Story AI ou Elefantia avant elle.
Pour collecter la matière qui servira de base à l’écrit, chacune a sa propre technique : le dépôt de souvenirs par des proches pour l’une ou des questions à l’oral ou à l’écrit pour les autres. « On va d’abord répondre à une dizaine de questions assez communes pour comprendre et déterminer les grands chapitres de sa vie ; les questions vont ensuite être plus poussées et personnalisés », précise Thierry Moncorger, cofondateur d’Elefantia. La force de l’IA entre alors en action pour retranscrire les conversations, ordonner le récit et le structurer en chapitres, très souvent dans un ordre chronologique. « L’IA n’invente rien, assure Baptiste Jeauneau. Tout part du récit de la personne et l’IA aide ensuite à la rédaction et à la mise en forme. »
Des seniors mais aussi une clientèle plus jeune
Lancée il y a un peu plus d’un an, l’application Elefantia est déjà utilisée par 8.000 utilisateurs et a déjà permis l’impression d’environ 500 biographies. Cela peut être en cadeau que l’on offre pour un anniversaire ou un départ à la retraite. Mais bien souvent, l’initiative vient de la personne qui souhaite se confier. « On a bien sûr des seniors et on travaille d’ailleurs avec les Ehpad, confie Thierry Moncorger. Mais on a aussi une clientèle plus jeune, plutôt des femmes de 35 à 50 ans qui veulent raconter les épreuves de la vie qu’elles ont vécues comme des deuils, des divorces ou des parcours de gestation pour autrui. On est plus là dans le domaine de l’écriture cathartique. »
Au final, le client repart avec son livre imprimé pour moins d’une centaine d’euros et un peu plus suivant selon le tirage. En option, Elefantia propose l’aide d’un étudiant en lettres qui aidera les aînés à maîtriser l’outil IA. « La présence d’un accompagnant permis aussi de libérer la parole », indique le cofondateur de la start-up qui a vu le jour à Saint-Malo.
« Une machine ne remplacera jamais l’humain »
Comme dans de nombreuses branches, ce raz de marée de l’IA générative suscite bien sûr des inquiétudes dans la petite communauté des écrivains publics. Fin mai, l’Académie des écrivains publics de France s’est d’ailleurs penchée sur cette question épineuse qui menace clairement leur travail. Certains l’utilisent d’ailleurs comme une aide sur des tâches répétitives ou pour la rédaction ou la construction de leur récit. « Mais ce qui fait notre plus-value, c’est l’échange et le contact humain, et aucune machine ne pourra remplacer ça », assure Delphine Berthon, écrivain public installé près de Rennes.
Plus qu’une simple plume, elle reconnaît d’ailleurs que les entretiens qu’elle mène avec ses clients ressemblent parfois à des séances chez le psy. « Ils me racontent parfois des choses intimes qu’ils n’ont jamais dites à personne. Et ça, l’IA n’arrivera jamais à le capter. »
Publié le 25 septembre 2025 par Alejandro Martínez
Note de Kat - Les enfants de ma nièce parlent espagnol en famille (la langue de leur père) et français à l'extérieur (la langue de leur mère et du pays où ils vivent). Et ils savent toujours quelle langue parler en fonction de leur interlocuteur. Mon beau-frère n'a pas eu la même démarche quand il a émigré aux USA en 1956. Mais ce n'était pas le même contexte. Leur fils Philippe avait 18 mois quand ils sont arrivés là-bas et Brigitte est née 18 mois plus tard. Les parents se sont efforcés de toujours parler anglais en présence de leurs enfants, pour faciliter leur intégration, c'était leur obsession. Même s'ils ont (eux, les parents) fini par être chacun professeur de littérature française dans une université. Mais une génération plus tard, Claudie parlait toujours français à ses petits enfants américains. Quand je l'ai rencontré, Philippe parlait français comme s'il avait des pommes de terre chaudes dans la bouche, mais Brigitte n'avait presque pas d'accent. Quant aux 5 petits enfants, seul Jeremiah comprenait parfaitement le français, mais refusait de le parler. Sa grand-mère avait une préférence pour lui et l'emmenait régulièrement au cinéma voir des films français en VO.
Même s’ils commencent à parler un peu plus tard, les enfants bilingues traitent les informations avec plus de souplesse. Voici ce qui se passe dans leur cerveau et comment favoriser ce processus.
Lorsque les enfants grandissent en entendant deux langues, leur famille et leurs enseignants s’inquiètent parfois : vont-ils s’embrouiller ? Vont-ils mettre plus de temps à parler ? Cela va-t-il affecter leurs résultats scolaires ?
Ces doutes sont compréhensibles : en effet, les enfants bilingues peuvent mettre un peu plus de temps à prononcer leurs premiers mots ou mélanger les deux langues au début. Cependant, il ne s’agit pas d’un retard pathologique, mais d’une étape naturelle de leur apprentissage. En réalité, ils traitent deux fois plus d’informations linguistiques, ce qui constitue un entraînement supplémentaire pour leur cerveau, qui s’en trouve renforcé de manière très bénéfique pour toute leur vie.
Que signifie être bilingue ?
Être bilingue ne signifie pas simplement parler couramment deux langues : une personne bilingue est celle qui utilise régulièrement les deux langues dans sa vie. Cela inclut ceux qui apprennent une langue à la maison et une autre à l’école, les enfants qui parlent une langue avec un parent et une autre avec l’autre, ou ceux qui vivent dans des communautés où deux langues sont couramment utilisées.
Mais est-on bilingue pour toujours ? La réponse est nuancée. Une personne peut cesser d’utiliser l’une de ses langues et, avec le temps, la perdre : perte de vocabulaire, de fluidité ou de précision. Cependant, même si la compétence pratique diminue, le cerveau conserve les traces de cet apprentissage précoce. Des études récentes montrent que les avantages cognitifs, tels que la flexibilité mentale ou la réserve cognitive, persistent même chez ceux qui ont cessé d’utiliser activement leurs deux langues.
Le cerveau bilingue en développement
Pendant l’enfance, le cerveau est très plastique. L’hypothèse de la période critique suggère que l’apprentissage précoce des langues favorise une organisation cérébrale plus intégrée : les réseaux neuronaux des différentes langues se chevauchent et coopèrent, au lieu de fonctionner séparément comme c’est souvent le cas chez les adultes.
Par exemple, un enfant qui apprend l’anglais et l’espagnol dès son plus jeune âge peut passer d’une langue à l’autre rapidement et naturellement, tandis qu’un adulte aura besoin de plus d’efforts et d’énergie pour changer de langue. Il existe diverses études de neuro-imagerie montrent que plus une deuxième langue est acquise tôt, plus ses réseaux neuronaux se superposent à ceux de la première langue, ce qui réduit l’effort nécessaire pour changer de langue.
Un double apprentissage, sans ralentissement
Dans la pratique, même si les enfants bilingues semblent commencer à parler plus tard, ils répartissent en fait leur vocabulaire entre deux langues. Si un enfant monolingue connaît 60 mots en espagnol, un enfant bilingue peut en connaître 30 en anglais et 30 en espagnol : le total est le même. En d’autres termes, ils progressent plus lentement dans chaque langue séparément, mais pas dans leur développement linguistique global.
Au-delà du vocabulaire, la gestion de deux langues dès le plus jeune âge entraîne le contrôle exécutif, qui comprend la capacité à se concentrer, à alterner les tâches et à filtrer les distractions. Par exemple, un enfant bilingue peut passer rapidement des instructions en espagnol à celles en anglais en classe, ou choisir la langue appropriée en fonction de son interlocuteur. Ces situations renforcent la mémoire de travail et l’attention soutenue.
Le cerveau bilingue supprime également temporairement la langue dont il n’a pas besoin dans chaque contexte. Ce processus, connu sous le nom de « contrôle inhibiteur », ne signifie pas « effacer » une langue, mais la désactiver momentanément afin que l’autre puisse s’exprimer sans interférence. Cette gymnastique cérébrale renforce les réseaux liés à la prise de décision, à la planification et à la résolution de problèmes.
Des avantages tout au long de la vie
Le bilinguisme n’apporte pas seulement des avantages pendant l’enfance : ses effets positifs peuvent perdurer même si, avec les années, l’une des langues n’est plus utilisée régulièrement. Même si cette deuxième langue peut être perdue, l’entraînement cognitif précoce continue à agir.
Par exemple, les personnes âgées qui ont grandi en parlant deux langues présentent plus de matière grise dans des zones clés du cerveau et peuvent retarder l’apparition des symptômes de la maladie d’Alzheimer.
Flexibilité cognitive
De plus, la maîtrise de deux langues favorise la flexibilité cognitive, c’est-à-dire la capacité à s’adapter à des situations changeantes. Lorsqu’un enfant ou un adolescent change de langue en fonction de son interlocuteur, lit un texte dans une langue puis explique la même idée dans une autre, il exerce sa capacité de concentration et d’attention focalisée dans d’autres contextes : jeux, conversations dans des environnements bruyants, changements inattendus en classe ou activités extrascolaires. Cette flexibilité lui permet d’acquérir de nouvelles compétences plus facilement.
La conclusion n’est pas que les personnes bilingues soient « meilleures » que les autres, mais que leur cerveau apprend à gérer les informations différemment, ce qui leur permet de relever plus facilement des défis variés.
Ces expériences contribuent à ce que les scientifiques appellent la « réserve cognitive », une ressource mentale qui protège le cerveau et aide à maintenir les capacités cognitives pendant des décennies, même chez les personnes âgées.
Comment tirer parti des avantages du bilinguisme
Encourager le bilinguisme ne signifie pas faire pression ou forcer les résultats, mais créer des contextes naturels d’exposition aux deux langues. Lire des histoires dans deux langues, regarder des films en version originale sous-titrée, chanter des chansons, jouer à des jeux de rôle ou avoir des conversations dans une langue étrangère sont des moyens informels de pratiquer sans en faire une obligation.
C’est important car, même si les programmes scolaires, tels que la méthode EMILE (enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère) ont un rôle à jouer, le bilinguisme quotidien s’enrichit dans des situations plus spontanées : cuisiner en suivant des recettes en français, jouer à des jeux vidéo en anglais ou partager des histoires familiales dans la langue maternelle. Ces expériences renforcent le lien émotionnel avec la langue et en font un outil vivant, au-delà de l’école.
Loin d’être un défi, l’exposition à deux langues est une opportunité pour les enfants de développer un cerveau flexible, bien connecté et capable d’organiser efficacement les connaissances. Grandir dans des contextes qui valorisent les deux langues permet de tirer parti de ces avantages cognitifs et culturels, en soutenant à la fois leur apprentissage scolaire et leur développement personnel.
Publié le 19 novembre 2025 par Hélène Bourelle
D'après une étude, réalisée par l'institut de sondage One Poll en juillet et août 2025 pour l'application d'apprentissage des langues Babbel, 33% de la population française a grandi avec un parent ou un grand-parent dont la première langue n'était pas le français. Mais parmi cet échantillon, un quart des Français et Françaises issu·es de l'immigration n'ont pas eu accès à cette transmission.
Naïma, 28 ans, est née à Paris d'une mère algérienne qui parlait berbère et arabe. «Ces langues étaient proscrites à la maison, confie-t-elle. Mes grands-parents préféraient parler dans un français approximatif, plutôt que de parler leurs langues maternelles. Ma mère aussi ne parlait que français, cherchant à tout prix à effacer son accent étranger.»
Une rupture linguistique au cours du XXe siècle
Le cas de Naïma est loin d'être isolé. D'après l'étude de One Poll pour Babbel, 39% des membres des deux générations d'immigrants d'après-guerre ont choisi de ne pas transmettre leur langue maternelle, parce qu'ils pensaient faciliter l'intégration de leurs enfants dans la société française. «Délaisser sa langue au profit du français est apparu aux premières générations d'immigrés comme un choix rationnel pour protéger leurs enfants des discriminations, dans une société qui stigmatisait fortement les langues étrangères», explique Sophie Vignoles, linguiste et responsable du contenu éducatif chez Babbel.
Dans un article intitulé «La dynamique des langues en France au fil du XXe siècle», publié en 2002 dans la revue Population et Sociétés, les sociologues et linguistes François Héran, Alexandra Filhon et Christine Deprez notent que si la part des adultes ayant hérité d'une langue étrangère de leur parents a progressé avec l'essor des migrations après la Seconde Guerre mondiale, la langue du pays d'origine a progressivement été abandonnée pour ne plus parler que le français en famille.
La non-transmission perçue comme un vecteur d'intégration
En 1999, dans leur «Étude de l'histoire familiale», l'Institut national d'études démographiques (INED) et l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) ont démontré que les langues étrangères les plus touchées par la non-transmission au cours de la seconde moitié du XXe siècle en France ont été le polonais, les langues créoles, l'italien, l'espagnol, les langues africaines, le berbère, l'arabe, le portugais ou encore l'allemand.
«Pour ma famille, la priorité était qu'on excelle à l'école et ça passait forcément par le fait de supprimer l'arabe et le berbère de nos vies.» Naïma, 28 ans, née à Paris d'une mère algérienne
Au fil des époques, l'immigration n'a cessé d'alimenter des débats récurrents sur l'identité, l'intégration et la cohésion nationale. Les politiques d'intégration ont, quant à elle, souvent valorisé l'assimilation linguistique, affectant la perception de soi et de sa langue d'origine chez les populations immigrées. «Pour beaucoup de nouveaux arrivés, effacer sa langue d'origine était perçu comme un facteur clé d'intégration sociale et une manière de maximiser les chances de réussite scolaire de ses enfants», précise Sophie Vignoles.
Une réalité vécue par Naïma: «Pour ma famille, la priorité était qu'on excelle à l'école et ça passait forcément par le fait de supprimer l'arabe et le berbère de nos vies.» On sait pourtant désormais que le fait de parler plusieurs langues couramment et/ou d'avoir plusieurs langues maternelles est un puissant levier de réussite scolaire, mais aussi un avantage sur les plans cognitif et social.
C'est en ressentant l'urgence de ses parents à s'intégrer qu'Anna, 40 ans, a fait un blocage avec le roumain. «Mon père, qui tenait un hôtel, racontait à ses clients qu'il était grec pour ne pas dévoiler sa véritable nationalité. Un jour, lorsque j'étais enfant, j'étais en train de parler en roumain et il m'a reprise en disant: “Ici, on est en France, alors on parle le français.” À partir de là, c'est comme si j'avais intériorisé la honte de mes parents à l'égard de leurs origines et je n'ai plus réussi à parler roumain, même avec ma famille au pays», retrace celle qui se prénomme en réalité Anne-Françoise. «Mes parents pensaient que ça faisait très français et avoir l'air français, c'était vraiment leur plus grand souhait.»
Un rapport aux langues intimement lié au contexte historique et sociétal
Le rapport à sa propre langue, qu'il s'agisse de fierté, de honte ou de rejet, dépend beaucoup de sa perception par le pays d'accueil. À 4 ans, lorsqu'elle a emménagé dans un village du sud de la France, Anja, 38 ans, a tout de suite intériorisé le regard négatif projeté sur sa langue maternelle, l'allemand.
«Avec mes sœurs, on était les seules étrangères, raconte Anja. J'ai ressenti le besoin très fort de me fondre dans la masse, mais nous étions sans cesse renvoyées à notre statut d'étrangères et d'ennemies. On nous traitait de “chleuhs”, de “boches”, de “nazis”. Alors j'ai fait un rejet total de la langue. Je ne répondais qu'en français quand ma famille me parlait allemand et j'ai tout fait pour effacer mon accent. Aujourd'hui, je ne parle plus du tout ma langue maternelle.» Les stéréotypes concernant l'allemand en France offrent un bon exemple du poids du contexte historique et politique sur la perception des langues.
Quant aux pays anciennement colonisés par la France, ils demeurent perçus à travers un prisme postcolonial, qui tend à invisibiliser leur langue, leur richesse culturelle et historique. «J'ai toujours senti que mon père s'empêchait de parler ses langues maternelles, le fon [ou fon-gbe] et le goun [ou gun-gbe], car elles n'étaient pas valorisées du tout, illustre Thibault, 38 ans, dont le père est originaire du Bénin. Il avait aussi très peur de faillir à cette injonction de s'intégrer. À cette époque, ce n'était pas envisageable d'avoir plusieurs identités. La notion même de métissage était un impensé. À l'école, on pensait que j'étais adopté car ma mère est blanche. C'était une période assez violente, qui ne laissait pas beaucoup de place à la diversité des cultures, des histoires, des parcours.»
L'injustice réside dans le fait que là où certaines langues étrangères subissent une dépréciation et un effacement, d'autres, à l'inverse, sont extrêmement valorisées. «Si mon père avait été britannique, tout le monde aurait été très fier qu'on apprenne et qu'on parle l'anglais entre nous. Ça aurait été perçu de manière unanime comme un levier de réussite scolaire et sociale», imagine Thibault.
La langue comme vecteur de mémoire et de continuité culturelle
Pour Sophie Vignoles, les langues sont loin d'être de simples outils de communication. Elles recèlent une quantité de composantes intangibles qui nous lient aux nôtres et aux autres. «Une langue est un vecteur d'émotions, d'histoire, de traditions. C'est une manière de voir le monde, mais aussi un fil invisible qui relie les générations entre elles, une porte vers la culture d'un pays et vers les autres. Lorsqu'on perd le contact avec la langue de ses parents ou de ses ancêtres, il y a tout un pan de notre histoire familiale et sociale qui disparaît.»
Un constat que fait aussi Ando, 28 ans, né en Arménie et arrivé en France à l'âge de 6 ans. «À la maison, on a toujours parlé l'arménien entre nous. On vient d'un peuple qui a vécu un génocide. Le pays ne compte aujourd'hui que 3 millions et quelques d'habitants. Alors c'est un peu notre devoir de faire vivre notre culture et notre mémoire. Sans la langue, elles disparaîtraient.»
«Il y a un vrai changement de génération. Au lieu d'un effacement, on assume aujourd'hui davantage son pluralisme linguistique et on revendique ses différentes identités.» Sophie Vignoles, linguiste et responsable du contenu éducatif de l'application Babbel
Aujourd'hui, Naïma regrette amèrement de ne pas parler la langue de ses origines algériennes. «Avec mes frères et sœurs, nous avons le sentiment d'avoir été privés de quelque chose qui aurait dû faire partie intégrante de notre identité, souffle la jeune Parisienne. Quand on va en Algérie, on se sent empêché, car on ne peut pas parler de manière fluide avec notre famille. Pour moi qui viens d'avoir un bébé, c'est une grande tristesse que de savoir que je n'aurai rien à lui transmettre à ce niveau-là.»
Même son de cloche pour Anna: «C'est un peu la double peine. En France, je ne devais pas parler roumain, mais en Roumanie, on me reprochait d'avoir oublié ma langue maternelle. Toutes ces années, cet état de fait m'a éloignée de ma famille et m'a empêchée de me sentir légitime là-bas.»
Une société plus ouverte qu'hier
Mais la société évolue et dans son sillage, les populations venues de l'étranger s'autorisent peut-être aujourd'hui plus qu'hier à transmettre leur langue maternelle à leurs enfants.
«Il y a un vrai changement de génération, note Sophie Vignoles. Au lieu d'un effacement, on assume aujourd'hui davantage son pluralisme linguistique et on revendique ses différentes identités.» Aussi, beaucoup d'individus issus des nouvelles générations sont déterminés à renouer avec ce qui ne leur a pas été transmis: «C'est une forme de réparation qui s'inscrit dans un véritable mouvement collectif qui participe à la modernisation de notre culture.»
Ando et sa famille incarnent bien ce changement de paradigme: «À travers les époques, par volonté d'être comme n'importe quel Français, les Arméniens ne se sont pas toujours autorisés à parler la langue avec leurs enfants. Nous, nous sommes arrivés dans un contexte différent, plus favorable, alors on se doit de faire ce travail de transmission.»
Ces dernières années, Anna a pris des cours de roumain auprès d'une prof particulière. «Parfois, j'ai un niveau d'enfant, parfois, je parle de manière très soutenue, tempère la quadragénaire. C'est très inégal, mais ce n'est pas grave. J'ai retrouvé certains réflexes et je me suis même remise à rêver en roumain.» Au fil du temps, Thibault se réapproprie lui aussi son héritage culturel venu d'Afrique de l'Ouest. «Je vais régulièrement au Bénin et j'essaie d'apprendre, petit à petit, témoigne de son côté ce trentenaire. C'est difficile, mais je m'accroche. Quoi qu'on en dise, ces langues font partie de moi.»
Quand Ursula veut "simplifier le numérique" il faut comprendre ici "permettre aux GAFAM de tout pomper sans demander".
« Faire simple ». C’est la nouvelle manie de la Commission européenne. Après avoir réglementé à tour de bras pendant une décennie, Bruxelles s’est soudain découvert une passion pour la “simplification du numérique”. Dans la grande tradition bruxelloise, “simplifier” signifie évidemment "supprimer ce qui dérange".
Le 19 novembre 2025, la Commission présentera son grand projet de “Digital Omnibus” : un paquet législatif censé harmoniser les lois sur les données, la cybersécurité et l’intelligence artificielle.
Mais derrière ce vernis technocratique se cache un programme autrement plus ambitieux : enterrer le RGPD et assouplir le règlement sur l’IA avant même qu’il ne soit appliqué.
L’“Omnibus numérique”, un bus qui écrase la vie privée
Le mot “omnibus” vient du latin “pour tous”. Dans ce cas précis, on pourrait le traduire par “contre tous”.
L’objectif officiel ? Réduire la “complexité” et la “fatigue du consentement” des utilisateurs.
L’objectif réel ? Abolir le consentement tout court.
Sous couvert de “cohérence” et de “réduction de la bureaucratie”, la Commission prévoit de fusionner ou modifier plusieurs textes : la loi sur les données, la directive sur les données ouvertes, le règlement sur la libre circulation des données non personnelles et la loi sur la gouvernance des données. Et, tant qu’à faire, d’y glisser un petit lifting du RGPD, histoire de le rendre plus “business friendly”.
RGPD : paix à ses données
Le RGPD, jadis symbole mondial de protection des données, se prépare à passer de "règlement général" à "suggestion facultative".
Le consentement devient optionnel : les entreprises pourront désormais justifier la collecte de données personnelles pour entraîner leurs IA au nom de leur “intérêt légitime” (votre visage, votre voix ou votre historique de navigation deviennent donc une matière première comme une autre).
Des cookies qui sont restés trop longtemps dans le four : le texte prévoit d’autoriser le pistage sans consentement explicite, à condition que cela relève de l’“intérêt légitime” du site. En clair, vous pourrez toujours refuser les cookies… mais après coup, dans un menu obscur, bien caché entre deux pop-ups de pub. La Commission appelle ça “réduire la fatigue du consentement”. Une idée lumineuse pour réponde à fatigué de cliquer sur “Non” ? On dira “Oui” à ta place !
Données sensibles, version allégée : l’article 9 du RGPD protégeait les données “révélant l’origine ethnique, les opinions politiques, la religion ou l’orientation sexuelle”. Désormais, seules les informations explicitement déclarées seront protégées. Du coup, si une IA déduit votre orientation sexuelle ou vos convictions religieuses à partir de votre historique de navigation, ce n’est plus une donnée sensible. Une avancée majeure pour la recherche scientifique ou pour la publicité ciblée, à vous de juger.
L’AI Act “simplifié”, ça veut dire "plus de liberté et moins de règles"
L’autre volet de la réforme, c’est la réécriture de l’AI Act, à peine entré en vigueur.
Officiellement, il s’agit d’alléger la charge pour les entreprises, officieusement, c’est une déprogrammation partielle des garde-fous avant même que la loi n’entre en application.
L’autocontrôle européen : la supervision des IA à risque sera centralisée dans un “AI Office” directement placé… sous la Commission elle-même. Un modèle d’indépendance et de transparence, on s’en doute.
Article 75 – Market surveillance and control of AI systems and mutual assistance
(1) Where an AI system is based on a general-purpose AI model, with the exclusion of AI systems related to products covered by the Union harmonisation legislation listed in Annex I, and the model and the system are developed by the same provider, the AI Office shall have powers to monitor and supervise compliance of that AI system with obligations under this Regulation in accordance with the tasks and responsibilities assigned by it to market surveillance authorities.
The AI Office shall have all the powers of a market surveillance authority provided for in this Section and Regulation (EU) 2019/1020 and be empowered to take the appropriate measures and decisions to adequately exercise its powers.
Article 14 of Regulation (EU) 2019/1020 shall apply mutatis mutandis. The authorities involved in the application of this Regulation shall cooperate actively in the exercise of these powers, in particular where enforcement actions need to be taken in the territory of a Member State.
Des obligations allégées : les entreprises pourront “simplifier” leur documentation technique, ne plus enregistrer certains systèmes “à faible risque”, et tester leurs IA dans des “conditions réelles” (traduction : sur le public). Quant aux PME et aux “small midcaps” (petites ETI), elles bénéficieront de “grâce administrative”, parce qu’un algorithme discriminatoire reste sympathique quand il vient d’une start-up européenne (Articles 11, 49 et 60 du projet Digital Omnibus – B – KI).
Le biais, cet “intérêt public” : le texte autorise explicitement les fournisseurs d’IA à traiter des données biométriques ou sensibles afin de “détecter et corriger les biais”.
Magnifique paradoxe : pour éviter la discrimination, on autorise les traitements discriminants.
Article 4a – Processing of special categories of personal data for bias detection and correction
“To the extent that it is necessary for the purpose of ensuring bias detection and correction (…) the providers and deployers of such systems may exceptionally process special categories of personal data, subject to appropriate safeguards for the fundamental rights and freedoms of natural persons.”
Suit une liste de conditions (a à f), parmi lesquelles :
- “the bias detection and correction cannot be effectively fulfilled by processing other data, including synthetic or anonymised data;”
- “the special categories of personal data are subject to technical limitations on the re-use (…) and state-of-the-art privacy-preserving measures, including pseudonymisation;”
- “the special categories of personal data are deleted once the bias has been corrected…”
Et on appelle ça innovation responsable !
“Fatigue du consentement” : une invention géniale
L’un des passages les plus savoureux du projet est consacré à la “fatigue du consentement”. Selon Bruxelles, les utilisateurs sont épuisés de devoir cliquer sur “Accepter” ou “Refuser” des cookies. La solution ? Les navigateurs décideront pour eux, via un signal automatique. Évidemment, “par défaut”, ce signal sera favorable à la collecte :-D
Et pour “préserver le journalisme indépendant”, les médias seront exemptés de ces règles. Rien de tel que le libre consentement… sauf quand il met en danger le modèle publicitaire.
Données de santé, génétique et biométrie deviennent un buffet à volonté
Le texte prétend maintenir une “protection renforcée” pour les données génétiques et biométriques. Mais en restreignant la définition des données sensibles, la Commission ouvre un boulevard :
les données de santé anonymisées, pseudonymisées, contextualisées… deviennent exploitables sans consentement.
Article 9 — Special categories of personal data
“The Commission wishes to ensure that sensitive data (‘special categories of personal data’) are defined in a narrower way.
Only data that explicitly reveal the information listed shall remain specially protected.”
[...]
“This means that if a person explicitly declares his or her sexual orientation in a selection field, this information remains specially protected.
However, if a controller infers a person’s presumed orientation based on interests or characteristics, the previous restrictions would be removed.”
Une bénédiction pour les assurances, les labos pharmaceutiques et les IA médicales “d’intérêt général”.
Simplifier la vie des entreprises, compliquer celle des citoyens
En résumé, le “Digital Omnibus” coche toutes les cases du cynisme administratif :
On appelle “innovation” la suppression des contrôles.
On baptise “harmonisation” la dérégulation.
Et on prétend défendre les citoyens en rendant leurs données exploitables “plus efficacement”.
À force de “simplifier” la réglementation, la Commission européenne est en train de simplifier la démocratie : moins de droits, plus de cases cochées par défaut.
Épitaphe du RGPD
Le RGPD aura donc vécu sept ans.
Né en 2016, mis en application dès 2018 et déjà mort en 2025 sous les coups de la “Simplification Act”.
Ursula von der Leyen peut être fière : elle a réussi ce que même les GAFAM n’osaient plus espérer : une Europe qui protège… ses partenaires commerciaux.
Sources :
Next
Netzpolitik
Loi omnibus sur les données et RGPD (PDF)
Loi omnibus sur l'IA (PDF)
Le vote, simple acte citoyen? Que nenni, assure une vaste étude menée par l'Université d'Helsinki, en Finlande. Selon cette dernière, le vote serait aussi un déterminant social crucial, un indicateur-clé de la santé et de la longévité des individus. Mieux encore, la participation électorale d'un individu serait un facteur prédictif de sa mortalité, plus puissant même que son niveau d'éducation.
Pour cette étude, les chercheurs ont croisé les données des élections parlementaires finlandaises de 1999 avec les registres officiels de Statistics Finland, qui recensent des informations détaillées sur la démographie, l'éducation, les revenus et les causes de décès. L'échantillon étudié comprenait 3.185.500 personnes, suivies pendant… plus de vingt ans! Balaise.
Moins on vote, plus on die
Sur cette période, 1.053.483 décès ont été enregistrés, dont 95.350 étaient dus à des causes externes (accidents, violences ou décès liés à l'alcool) et 955.723 à d'autres causes sous-jacentes. Des données dont se sont emparés les scientifiques pour trouver des résultats stupéfiants.
Les conclusions sont claires: l'abstention s'accompagne d'un risque de mortalité nettement supérieur. Les hommes qui ne votent pas présentent un risque de décès toutes causes confondues supérieur de 73% à celui des électeurs, tandis que chez les femmes, ce sur-risque atteint 63%. Même après avoir tenu compte du niveau d'éducation, l'écart demeure marqué, +64% pour les hommes et +59% pour les femmes.
Plus surprenant encore, la différence de mortalité entre électeurs et abstentionnistes dépasse celle constatée entre les personnes peu instruites et celles titulaires d'un diplôme supérieur. Cela suggère que le fait de voter apparaît comme un indicateur social de santé quasi plus déterminant que le niveau d'instruction, pourtant solidement ancré en sciences sociales.
Lien n'est pas causalité
D'autres résultats viennent compléter ces observations, notamment selon l'âge et le revenu. Chez les hommes de moins de 50 ans, par exemple, le risque de décès est deux fois plus élevé pour les non-votants que pour les électeurs. Côté revenu, le constat est à peu près similaire: chez les hommes appartenant au quart des ménages les plus modestes, l'abstention s'accompagne d'un risque de décès 9 à 12% plus élevé que dans les groupes de revenus plus élevés.
Que faut-il en conclure? Déjà, que ces résultats doivent être pris avec des pincettes. Il s'agit ici d'une étude observationnelle, qui ne permet pas d'établir un lien de causalité direct. De nombreux obstacles structurels peuvent aussi influencer la participation électorale, comme les difficultés de mobilité, l'isolement social ou la précarité économique.
Comme l'expliquent eux-mêmes les chercheurs, leurs résultats ouvrent une nouvelle piste de réflexion, traçant un nouveau sentier d'analyse que de futures études devraient explorer pour déterminer dans quelle mesure le vote est un marqueur précieux pour comprendre les inégalités de santé.
En résumé, ces travaux ouvrent une nouvelle perspective: le vote pourrait être un indicateur pertinent pour identifier les disparités en matière de santé, et des études futures pourront approfondir ce lien pour en comprendre tous les mécanismes.
En fin de semaine dernière, plusieurs médias européens ont obtenu un brouillon de la loi « omnibus numérique » que prévoit de présenter la Commission européenne dans les prochaines semaines. Alors qu'elle présentait son texte comme une « simplification » des textes, l'analyse de ce document montre que le projet va beaucoup plus loin et fait dire au responsable de l'association noyb, Max Schrems, que « ces changements sont extrêmes et ont des répercussions considérables ».
Comme l'indique le média allemand Netzpolitik, la Commission a en fait séparé sa proposition en deux textes : l'un sur la « simplification » de différents textes sur le numérique déjà en application [PDF], l'autre est plus spécifiquement sur l'IA et affiche la volonté de « simplifier » l'AI act [PDF], alors que celui-ci commence tout juste à s'appliquer progressivement jusqu'à devenir pleinement effectif à partir du 2 aout 2027.
Une volonté de laisser tranquille l'industrie de l'IA en Europe
La refonte prévue par ce texte des lois protégeant les données au sein de l'Union européenne est clairement prévue pour laisser la voie libre aux entreprises d'IA générative dans le but affiché de les aider à rester compétitives sur la scène internationale. Elle pourrait permettre aussi à des entreprises comme Meta de lancer sur le marché européen des produits comme ses lunettes connectées boostées à l'IA avec un peu moins de risques de se faire attraper par la patrouille.
Dans une réaction publiée sur LinkedIn, le responsable de l'association noyb, Max Schrems, a publié le texte de ce brouillon accompagné des commentaires de noyb.
L'entrainement des IA comme un « intérêt légitime »
En question dans ces « simplifications » du RGPD, notamment, la volonté de prendre en compte l'entrainement des IA comme un « intérêt légitime ». Ainsi le texte affirme qu' « une IA fiable est essentielle pour assurer la croissance économique et soutenir l'innovation avec des résultats bénéfiques pour la société ».
La Commission fait le constat que « le développement et l'utilisation de systèmes d'IA et des modèles sous-jacents, tels que les grands modèles de langage et les modèles de génération de vidéo, reposent sur des données, y compris des données à caractère personnel, à différentes étapes du cycle de vie de l'IA, telles que les phases d'entrainement, de test et de validation, et peuvent dans certains cas être conservées dans le système ou le modèle d'IA ». Elle en conclut que « le traitement des données à caractère personnel dans ce contexte peut donc être effectué à des fins d'intérêt légitime au sens de l'article 6 » du RGPD.
Des critiques des fondateurs du RGPD
Sur ce sujet, noyb considère que la Commission s'engage dans une « pente glissante » : « si l'on estime qu'il existe un intérêt légitime à "scraper l'intégralité d'Internet" et toute autre donnée d'entraînement disponible, à quelque fin que ce soit, sans le consentement des utilisateurs, il n'y a guère d'autres traitements qui ne relèveraient pas d'un "intérêt légitime" », commente l'association.
« Celui qui a rédigé ce projet avait une vision étroite de la (prétendue) "course à l'IA" et a tout simplement "balayé" le RGPD de nombreuses façons qui porteront préjudice à des personnes dans des centaines d'autres domaines (minorités, suivi en ligne, personnes souffrant de problèmes de santé, etc.) », a réagi Max Schrems dans son post sur LinkedIn.
« Il ne restera plus rien de la protection des données, car l'IA est omniprésente », considère de la même façon Paul Nemitz, ancien directeur du département juridique de la Commission européenne et un des fondateurs du RGPD.
« Est-ce la fin de la protection des données et de la vie privée telles que nous les avons inscrites dans le traité de l'UE et la charte des droits fondamentaux ? », s'est interrogé un autre des artisans du règlement européen, l'ancien eurodéputé Jan Philipp Albrecht cité par Politico. « La Commission doit être pleinement consciente que cela porte gravement atteinte aux normes européennes », ajoute-t-il.
Le respect d'un « do not track » obligatoire, sauf pour les médias
Le brouillon de la loi « omnibus numérique » prévoit aussi de simplifier l'utilisation des bandeaux de consentement aux cookies. Comme nous l'avions évoqué en septembre dernier, la Commission veut réduire l'affichage des bandeaux qui inondent le web. Elle envisage de mettre en place une automatisation de la réponse, à la manière d'un « do not track » très peu pris en compte actuellement, que l'utilisateur pourrait paramétrer soit dans son navigateur soit dans son système d'exploitation.
Les responsables des sites internet auraient l'obligation de prendre en compte ce mécanisme. Mais les rédacteurs y mettent une exception pour les sites de médias, comme le relève le site Heise. Ainsi, le texte indique que « compte tenu de l'importance du journalisme indépendant dans une société démocratique et afin de ne pas compromettre sa base économique, les fournisseurs de services de médias ne devraient pas être tenus de respecter les indications lisibles par machine relatives aux choix des personnes concernées ».
Cela permettrait aux médias de passer outre le consentement des utilisateurs et leur garantir la pérennité de leurs revenus provenant des publicités ciblées.
Les feuilles de styles complexes font souvent apparaître des contradictions entre les différentes règles. Cela se produit lorsqu'une propriété reçoit des valeurs différentes, avec des sélecteurs différents mais qui ciblent un ou plusieurs éléments identiques.
Cette page décrit le mécanisme standard de CSS pour résoudre ces conflits. Vous pourrez également vous reporter à la page sur la directive @layer qui permet de mettre en œuvre une autre gestion des priorités : les couches de cascade.
Les règles contradictoires.
Il arrive fréquemment que plusieurs règles CSS soient contradictoires. Cela se produit chaque fois que l'on tente d'affecter des valeurs différentes à une même propriété.
Par exemple, les deux règles CSS suivantes se contredisent sur le premier paragraphe. En effet, la première règle demande que l'élément dont l'identifiant est parag1 soit en rouge, tandis que la deuxième règle demande que les paragraphes soient en bleu. L'élément parag1 étant lui-même un paragraphe, il y a contradiction.
#parag1a {color:red;}
.exemple1 {color:blue;}Voici comment s'affichera le code présenté ci-dessus. On voit que ce n'est pas nécessairement la dernière règle rencontrée qui est prioritaire par rapport aux précédentes. Dans cet exemple on voit que le sélecteur par identifiant ( # ) est prioritaire sur un sélecteur par type d'élément ( p ) : le style appliqué sur l'ID (couleur rouge) est prioritaire sur celui qui est appliqué sur la classe (couleur bleue) bien que ce dernier soit énoncé après.
p id="parag1a" class="exemple1a"
Le premier paragraphe.
/p
p id="parag1b" class="exemple1"
Le deuxième paragraphe.
/p
p id="parag1b" class="exemple1"
Le troisième paragraphe.
/p
Les priorités des sélecteurs.
Rappel : le sélecteur est ce qui détermine sur quel(s) élément(s) une règle CSS s'applique. Dans l'exemple ci-dessous, le sélecteur est .encart. Il désigne tous les éléments comportant l'attribut class="encart".
.encart {border:solid 1px silver;}Tous les sélecteurs n'ont pas la même priorité. En cas de contradiction entre deux règles, celle qui s'applique est celle qui a le sélecteur le plus prioritaire. De façon générale, les sélecteurs ont une priorité d'autant plus grande qu'ils sont plus précis. Le sélecteur très général * a une priorité de 0. A l'inverse, un sélecteur sur un identifiant, qui en principe ne concerne qu'un seul élément de la page, à une priorité de 100.
Pour déterminer la priorité d'un sélecteur, il faut considérer la logique suivante :
Une règle avec la mention !important a une priorité de 10000.
Une règle écrite dans l'attribut style d'une balise HTML a une priorité de 1000.
Une règle avec un sélecteur sur un identifiant ( # ) a une priorité de 100.
Une règle avec un sélecteur sur une classe ( . ) ou des pseudo-classe ( : ) a une priorité de 10.
Une règle avec un sélecteur sur un type d'élément ( p ) ou des pseudo-élément ( :: ) a une priorité de 1.
Le sélecteur étoile ( * ) a une priorité de 0.Les animations sont prioritaires par rapport à toutes les autres déclarations, sauf celles qui sont notées !important. Ce qui est logique sinon les animations ne pourraient jamais s'exécuter. Voir le tutoriel sur les animations en CSS.
Les transitions sont prioritaires par rapport à toutes les autres règles, y compris celles comportant la mention !important. Voir la propriété transition.
Lorsqu'un sélecteur comporte plusieurs parties combinées, les priorités de chacune des parties s'additionnent pour donner la priorité globale du sélecteur.
Une exception cependant : lorsque le sélecteur est composé de plusieurs parties séparées par des virgules, chaque partie est considérée comme un sélecteur à part entière. Chacune des parties peut éventuellement recevoir une priorité différente.
Enfin, lorsque deux règles contradictoires ont un sélecteur de même priorité, la dernière règle rencontrée remplace les valeurs définies par les règles précédentes.
Exemples :
/* Sélecteur sur un identifiant -> priorité = 100 */
#edito {color:blue;}
/* Sélecteur sur une pseudo-classe -> priorité = 10 */
:link {color:inherit;}
/* Sélecteur sur un type d'élément -> priorité = 1. */
p {font-size:1.1em;}
/* Règle comportant la mention !important -> priorité = 10000 */
p {color:silver!important}
/* Sélecteur désignant les images enfants l'élément #edit -> priorité = 101 */
#edit img {width:25%;}
/* Sélecteur désignant les images enfants direct d'une cellule -> priorité = 2 */
td > img {width:100%;}Quelques sélecteurs particuliers.
Les sélecteurs :is() et :has() prennent la priorité du sélecteur le plus sélectif parmi ceux passés en arguments.
:is(#edito, .introduction) /* Priorité = 100 (celle de #edito) */
:has(img) /* Priorité = 1 (celle d'un sélecteur par balise) */Le sélecteur :not() prend la priorité du sélecteur passé en argument.
:not(:first-line) /* Priorité = 10 (celle d'une pseudo-classe) */Le sélecteur :where() a une priorité de 0, bien que ce soit une pseudo-classe.
La valeur !important.
Le mot !important peut être ajouté à n'importe quelle valeur dans une règle CSS. Il rend la règle prioritaire. L'exemple ci-dessous est identique au premier sauf que !important figure dans la deuxième règle. On voit que la priorité des règles a été changée.
Le premier paragraphe.
Le deuxième paragraphe.
Remarque : la mention !important est à utiliser le moins possible.
L'emplacement des styles.
Les choses se compliquent si on considère que :
Plusieurs feuilles de styles peuvent être associées à une même page.
Des styles peuvent être écrits dans la page elle-même (dans la section head) ou dans l'attribut style des balises HTML.
Le navigateur dispose de sa propre feuille de styles, appliquée à toutes les pages qu'il affiche.
L'utilisateur (le lecteur ou l'internaute) peut lui-même définir ses propres styles.
Pour cette raison nous devrons distinguer les styles de l'utilisateur (l'internaute) et les style de l'auteur (celui qui crée le les pages).
Les styles de l'utilisateur sont peu utilisés et ont tendance à disparaître complètement. Voir le paragraphe sur les feuilles de styles utilisateur plus bas dans cette page.Cela fait apparaître trois sortes de styles : les styles du navigateur, ceux de l'auteur (le web designer qui a travaillé sur le site) et ceux de l'utilisateur (l'internaute).
Le traitement de toutes ces feuilles de styles est effectué dans l'ordre suivant :
Le navigateur effectue une première résolution des conflits sur sa propre feuille de styles. Les valeurs obtenues seront utilisées si aucun autre style ne vient les modifier.
Dans un deuxième temps, il résout les conflits éventuels entre les sélecteurs de la feuille de styles de l'utilisateur. Les valeurs obtenues remplacent celles de la feuille de styles du navigateur.
Enfin le navigateur résout les conflits des sélecteurs sur la ou les feuilles de styles jointes à la page (balise link) et sur les styles décrits dans la page elle-même entre les balises style et /style). Les valeurs obtenues seront celles qui seront finalement utilisées.Cependant, comme la possibilité laissée à l'utilisateur de définir ses propres styles est en voie de disparition, nous pouvons simplifier tout ça et considérer que :
Le navigateur affecte les valeurs définies dans sa propre feuille de styles après résolution des conflits éventuels.
Le navigateur résout les conflits de sélecteurs sur les styles de l'auteur et applique les valeurs obtenues à la place de celles de sa propre feuille de styles.Il faut bien noter une chose qui est souvent mal comprise : les styles écrits dans la page elle-même, entre des balises style et /style, dans le section head, sont considérés avec la même priorité que les styles auteur provenant d'une feuille de styles externe. Firefox semble cependant leur donner un petit avantage en les explorant après les styles de la feuilles externe : ils peuvent donc être légèrement prioritaires si toutes les autres règles de priorité sont neutres.
En résumé, voici comment sont gérées les priorités entre les différentes feuilles de styles, en considérant également la valeur !important. La liste ci-dessous est triée du plus prioritaire au moins prioritaire.
Les effets de transition.
Les règles notées !important de la feuille de styles du navigateur.
Les règles notées !important de la feuille de styles de l'utilisateur.
Les règles notées !important de la feuille de styles de l'auteur.
Les animations.
Les règles de la feuille de styles de l'auteur.
Les règles de la feuille de styles de l'utilisateur.
Les règles de la feuille de styles du navigateur.L'inspecteur.
Il existe un outil particulièrement pratique, fourni par la plupart des navigateurs et souvent nommé "l'inspecteur". On l'active en faisant un clic droit sur un des éléments de la page web affichée :
clic droit -> inspecter
L'inspecteur présente des quantités d'informations, aussi bien sur le code HTML, que sur les règles CSS appliquées à l'élément sur lequel on a cliqué. Il montre très bien en particulier la règle qui est active et celles qui ont été surchargées par une autre règle de priorité supérieure : les règles surchargées sont rayées.
L'inspecteur de styles, dans Chrome
Styles définis par l'attribut style de HTML.
Styles définis entre les balises style.../style dans la section head de la page.
Styles définis dans la feuille de styles externes.
Styles définis dans la feuille de styles du navigateur.
La feuille de styles utilisateur.
La feuille de styles utilisateur permet à l'utilisateur, c'est à dire l'internaute, de définir ses propres styles, qui seront appliqués à toutes les pages affichées.
Cette possibilité est peu utilisée et n'est finalement pas très utile car les styles définis par l'utilisateur sont appliqués à toutes les pages, sans qu'il soit possible de faire de différence d'un site à l'autre.
Chrome a désactivé cette possibilité. Firefox ne l'active plus par défaut. Il est cependant possible de l'activer sur Firefox avec le flag toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets (accéder aux flags sur Firefox). Il eput être nécessaire de redémarrer Firefox.
Les styles utilisateur doivent être écrits dans un fichier nommé userContent.css et enregistré dans le dossier de profil. Pour créer ou éditer ce fichier procéder de la façon suivante :
Taper about:support dans la barre d'adresse.
Chercher Profile folder et cliquer sur le bouton Open folder. Le dossier de profil s'ouvre dans l'explorateur Windows.
Créer si nécessaire un sous-dossier nommé chrome en minuscules (oui c'est étonnant, le dossier s'appelle "Chrome").
Créer ou éditer le fichier userContent.css : écrire les styles utilisateur dans ce fichier.
Redémarrer Firefox.Et les attributs HTML ?
A une époque déjà lointaine, il était courant de définir une mise en forme directement par des attributs HTML.
h1font color="blue">Titre de la page/fonth1Les styles CSS sont TOUJOURS prioritaires sur les attributs HTML autres que style. Les attributs tels que color, size, etc. ne devraient d'ailleurs plus être utilisés puisqu'ils ne sont plus standardisés depuis HTML5.
Évolution des règles de priorité.
La gestion des priorités est, pour l'essentiel, resté inchangée depuis la première version du langage CSS. Le niveau 3 a simplement pris en compte les animations et les transitions dans l'ordre des priorités.
Voir aussi, au sujet des priorités.
Les spécifications CSS éditées par le W3C sont organisées en modules. La propriété ref-priorities fait partie du module CSS Cascading and Inheritance. Les définitions suivantes sont également décrites dans ce module.
Propriétés :
all : Initialisation de toutes les propriétés.
Directives :
@import : Importation d'une feuille de styles.
@layer : Définit les couches de cascade (layer) pour faciliter la gestion des priorités entre les règles CSS.
Valeurs:
!important : Rend une règle prioritaire sur toutes les autres.
inherit : Donne à une propriété la même valeur que celle de l'élément parent.
initial : Redonne à une propriété sa valeur initiale.
revert : Donne à une propriété la valeur définie par le navigateur.
revert-layer : Rétablit la valeur d'une propriété à la valeur qu'elle avait à la couche précédente.
unset : Donne à une propriété la valeur qu'elle aurait eu si aucun style ne l'avait changée.
Virée californienne avec Jean-Pierre Dupuy par Matheo Malik
Nous allons parler de la Californie. Pourriez-vous nous raconter votre premier rapport avec cet État si important pour vous : se fait-il d’abord par des lectures ?
L’image que je me faisais de la Californie avant de m’y rendre pour la première fois, en 1981, était bien différente de ces cartes postales représentant de hauts palmiers bordant d’interminables plages de sable fin, réchauffées par un soleil toujours présent.
Les noms de Malibu ou de Santa Monica font rêver beaucoup de gens.
Je vais peut-être vous étonner, mais je voyais quant à moi la Californie sur le mode d’un roman ou d’un film noir : tragique, mélancolique, désespérée, marquée par le signe du destin ou de la fatalité.
Jeune, j’étais un lecteur passionné de Raymond Chandler (Le grand sommeil) et de James Cain (Le facteur sonne toujours deux fois). J’écoutais en boucle le jazz « cool » de la Côte ouest : Gerry Mulligan, Chet Baker, Dave Brubeck. Surtout, des films dont le cadre était la Californie me confirmaient qu’il y avait dans ce lieu comme un sortilège, à la fois attirant et malfaisant : d’Orson Welles, Citizen Kane et A Touch of Evil ; d’Hitchcock, Shadow of a Doubt, Vertigo, Les Oiseaux ; plus tard, de Polanski, Chinatown, et le premier film réalisé par Clint Eastwood, Play Misty For Me.
Je pense que nous reviendrons sur Vertigo, mais tous ces films — de purs chefs-d’œuvre — m’envoûtaient.
Pour éviter tout malentendu, je tiens à ajouter deux choses.
Aujourd’hui, après plusieurs décennies de fréquentation assidue de cette région du monde, ma vision n’a pas fondamentalement changé. Ensuite, le tragique et la mélancolie dont j’ai parlé ne sont pas, pour moi, des passions tristes ou négatives, tout au contraire. Ce sentiment a inspiré certaines des plus belles œuvres d’art, en musique, en littérature, en peinture et au cinéma. Mes goûts me portent vers ces œuvres-là. Celles que la Californie a inspirées en font partie.
Je préférais au fond que la Californie restât comme une fiction au-delà du réel. Jean-Pierre Dupuy
Votre première rencontre avec les États-Unis a lieu au cours d’un voyage d’études lorsque vous êtes étudiant à l’École Polytechnique. Quand arrivez-vous pour la première fois en Californie — et pourquoi ?
Je prends votre « pourquoi ? » au sens de « pourquoi si tard ? »…
En effet, entre mon premier voyage aux États-Unis et ma découverte de la Californie, il s’est passé 20 ans. Pendant cette période, mon activité de chercheur en philosophie et sciences humaines m’a conduit régulièrement à me rendre dans les universités de la côte est, comme Harvard à Boston, Johns Hopkins à Baltimore, Princeton et l’Institute of Advanced Studies, et parfois dans le Midwest, à l’université du Wisconsin à Milwaukee. Je ne manquais jamais de rendre visite à New York pour mon plaisir, mais la pensée de me rendre en Californie ne me venait pas à l’esprit.
Pourquoi ? Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question, sauf en revenant à ce que je vous ai dit précédemment. La Californie était pour moi avant tout une image ambivalente, comme le sacré et j’avais sans doute le sentiment vague que je commettrais un sacrilège en y posant le pied. Je préférais au fond qu’elle restât comme une fiction au-delà du réel.
C’est une occasion inespérée qui m’a finalement poussé à franchir le pas.
Je connaissais René Girard pour avoir écrit sur son œuvre un ouvrage critique, en compagnie du philosophe canadien Paul Dumouchel. Au mois de juillet 1981, Paul et moi avions organisé un colloque international au centre culturel de Cerisy-la-Salle, en Normandie, sur le thème « L’auto-organisation, de la physique au politique ». Pour beaucoup de ceux qui y ont participé, ce colloque fut un tournant dans leur vie, intellectuelle mais aussi personnelle. René Girard faisait partie des invités alors même qu’il venait d’être recruté par l’université Stanford, en Californie. Il m’invita à organiser un colloque semblable dans son nouveau milieu, ce que je fis en un temps record. L’auto-organisation, c’est la constitution d’un ordre à partir du désordre sans qu’aucun « designer », ni Dieu ni la nature, n’en ait tracé le plan à l’avance. C’est tout naturellement que le colloque de Stanford, qui eut lieu en septembre de la même année, s’intitula « Disorder and Order ». Ce fut aussi un grand succès.
L’université californienne m’offrit un poste de professeur invité et, un an plus tard, je devins professeur titulaire à temps partiel. C’est ce poste que j’occupe encore aujourd’hui.
Paysage de San Francisco qui sert de décor au film matriciel de la Californie de Dupuy : Vertigo de Hitchcock
Diriez-vous que vous avez un rapport ambivalent avec la Californie, alors même que votre premier contact avec les États-Unis fut comme un « coup de foudre », selon vos propres paroles ?
Par définition, on n’explique pas un coup de foudre. J’avais 21 ans et ne connaissais l’Amérique qu’à travers les représentations dont j’ai parlé. New York m’a ébloui. Comme dirait plus tard Jean Baudrillard, cette ville, la Gotham des comic books, m’apparaissait comme la copie parfaite de ses représentations. Elle était la copie de ses copies, c’est-à-dire un simulacre. De ce choc initial, je ne suis pas encore revenu.
Ma découverte de la Californie fut tout autre. Pour vous faire comprendre ma déception, je dois vous révéler que mon deuxième pays n’est pas la Californie, mais le Brésil, le pays de mes enfants et de mon petit-fils. Les plages infinies de sable fin, c’est là qu’on les trouve, à Salvador da Bahia, à Porto Seguro ou sur l’île de Jaguanum nichée dans la baie d’Angra dos Reis, au sud du pays. Mais l’Océan Pacifique qui borde la Californie sur 1350 km, cette étendue d’eau noire et froide peuplée d’une faune qui est davantage celle des régions arctiques que celle des régions méditerranéennes, d’emblée me repoussa. Il est certes excitant de voir des baleines grises et des orques se prélasser dans la baie de Monterey et des colonies d’otaries et de lions de mer bêler et rugir, perchées sur des rochers au large de Big Sur. Mais ce ne sont pas les Tropiques. On en est si loin que l’eau est glaciale au point que nul ne peut s’y baigner sans porter une combinaison en néoprène.
Ne parlons pas du climat. En été, dans la région de San Francisco, il se forme à la rencontre de l’air frais de l’océan et de la chaleur des terres un brouillard si épais que pendant six mois, d’avril à septembre, la ville grelotte de froid. Le grand poète San-Franciscain Robert Frost a pu dire : « L’hiver le plus froid que j’ai jamais connu, était un été à San Francisco. »
Tel fut mon premier contact. Au fil des ans, j’ai appris à aimer la beauté de la Californie. C’est une beauté qui se mérite. La littérature et la poésie m’ont grandement aidé. Ses côtes fantastiquement escarpées, ses arbres multimillénaires, ses montagnes aux formes admirables, ses villes de fin du monde, font de la Californie un lieu exceptionnel.
La Californie, ce ne sont pas les Tropiques. On en est si loin que l’eau est glaciale. Jean-Pierre Dupuy
Qu’est-ce que la Californie aura représenté pour vous, dans votre vie et votre travail ?
La Californie est très vaste. Sa surface représente les deux tiers de celle de la France. La Californie que j’habite n’est qu’une partie de ce grand ensemble. On la nomme la Bay Area, c’est-à-dire la région de la baie de San Francisco. Un peu moins de 8 millions de personnes y habitent, soit 20 % de la population totale de l’État. Mais c’est une région que le monde entier croit connaître, car s’y trouve ladite Silicon Valley, ce haut lieu des technologies parmi les plus avancées qui se déploie autour de l’université Stanford.
Celle-ci est rattachée à la ville de Palo Alto, dont le nom espagnol signifie le haut arbre, en l’occurrence un séquoia géant. Mais la région de la baie abrite d’autres universités importantes, en particulier plusieurs campus de l’université de l’État de Californie (UC), comme Berkeley, San Francisco et Davis. Les laboratoires Lawrence Livermore, qui ont joué un rôle essentiel dans le développement de l’arme nucléaire américaine, font partie de cet ensemble.
Que dire en quelques mots de ma vie dans ce décor depuis quarante ans ?
En premier lieu, et c’est essentiel, j’y ai trouvé une compagne, une Américaine issue du Midwest profond mais l’ayant quitté jeune pour rejoindre la côte Pacifique. Je ne vais sûrement pas vous parler de choses intimes mais je peux dire ceci, compte tenu des circonstances actuelles. Comme beaucoup de ses compatriotes mais pas assez nombreux, elle souffre atrocement et a honte de son pays, qu’elle ne reconnaît plus. Trop de gens autour d’elle, s’ils ont voté Trump, ne font aucun effort pour sortir de leur ignorance crasse et parmi les autres, beaucoup courbent l’échine parce qu’ils ont peur : peur de perdre leur emploi, peur que leur couverture médicale fédérale (Medicaid) disparaisse, peur de perdre leurs crédits de recherche, etc. Le président de Stanford, récemment nommé, a piteusement refusé de joindre sa signature à la lettre de soutien à Harvard que plusieurs de ses collègues ont concoctée.
J’ai appris une leçon importante en vivant ici : le respect du travail.
Le rapport au travail conjugue deux traits que dans d’autres cultures, on jugerait incompatibles : le très grand sérieux que l’on porte à cette activité et le fait que l’on ne s’identifie pas à sa profession. On sait qu’on pourrait facilement en changer : si la Californie était un État-nation, ce serait la quatrième puissance économique mondiale. Le statut et la peur du « déclassement » sont des notions qui jouent un rôle bien moindre qu’en France. On peut sans humiliation se retrouver garçon de café le temps de retrouver un emploi, en recevant d’ailleurs des pourboires faramineux (plus de 20 ou 25 %). La référence ici est moins le livre de Max Weber sur l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme que l’opuscule du philosophe chrétien Jacques Maritain intitulé Réflexions sur l’Amérique, qui date de 1958. Un chapitre savoureux traite du « sourire de la serveuse de restaurant ». Bien sûr, l’esprit cynique des Gaulois ne sait voir dans ce sourire qu’un argument commercial. Mais Maritain va jusqu’à y déceler une promesse de paradis. Il n’a rien à voir en tout cas avec l’attitude grincheuse du garçon de café qui vous fait payer le ressentiment qu’il éprouve à faire un métier qui n’est pas digne de lui.
Le rapport au travail conjugue deux traits que dans d’autres cultures, on jugerait incompatibles : le très grand sérieux que l’on porte à cette activité et le fait que l’on ne s’identifie pas à sa profession. Jean-Pierre Dupuy
Comment le film Vertigo a-t-il influencé votre relation avec San Francisco et la Californie en général ?
Nous voici revenus à mon rapport fantasmé à la Californie. J’ai expliqué ailleurs 1 que ma vie et mon parcours philosophique ont été irrévocablement marqués par le choc que j’ai reçu pendant mon adolescence en voyant ce chef-d’œuvre métaphysique dû au génie d’Alfred Hitchcock.
Je sais que je ne suis pas seul dans ce cas.
Inévitablement, la découverte que cette fiction avait un support matériel, à savoir tous les lieux de San Francisco et de ses environs où Hitchcock planta sa caméra, a eu un impact sur mon rêve. Cet impact aurait été uniquement négatif si je ne m’étais efforcé de maintenir le rêve en vie par divers moyens qui relèvent de ce que la philosophie analytique de l’esprit nomme la self-deception et de ce que Sartre a appelé la mauvaise foi. L’un de mes cours les plus réussis a porté justement sur la confrontation entre ces deux manières de penser le mensonge à soi-même.
Je suis devenu pour l’éternité Scottie Ferguson, l’homme qui ne peut empêcher les femmes de tomber dans l’abîme. Jean-Pierre Dupuy
Ce jeu de l’esprit a connu son climax avec le colloque que j’ai organisé à Stanford pour célébrer le 50ème anniversaire du film, en 2008 donc. La liste des participants avait ceci d’original que les spécialistes du cinéma d’Hitchcock, et même du cinéma américain en général en furent bannis. Seuls ceux et celles qui, comme moi, avaient eu leur vie changée et façonnée par Vertigo avaient droit à la parole. Aucun enregistrement des débats n’a eu lieu. Il ne reste donc rien de cette rencontre autre que le souvenir que chacun en a gardé. Outre la projection du film, que je voyais peut-être pour la cinquantième fois, le clou de ces trois journées a été la visite des lieux où il a été tourné : entre autres, la mission Dolores à San Francisco et le cimetière adjacent, le Golden Gate Bridge, la Coit Tower, Nob Hill, l’intersection des rues Lombard et Jones, la plage Stinson, la mission de San Juan Bautista au sud de la Bay Area et Muir Woods au nord du Golden Gate.
Êtes-vous définitivement devenu un personnage du film de Hitchcock en Californie ?
C’est à l’occasion de ce colloque que j’ai, pour la première fois de ma vie, parlé en public de Vertigo.
Mais, j’ai aussi pu, grâce à une amie, Christine Suppes, donner une seconde conférence dans un lieu très spécial.
Le personnage principal du film est une fiction — comprendre, une fiction dans la fiction que constitue le film. Nommée Madeleine, cette fiction habite fictivement au sommet de l’une des sept collines de San Francisco, Nob Hill, au dernier étage d’un immeuble célèbre, le Brocklebank Apartments. C’est dans un appartement correspondant à cette description que j’ai parlé de cette femme imaginaire et de celui qui tombe éperdument amoureux d’elle, le détective privé Scottie Ferguson. Mon amie avait préparé une très grande affiche représentant une spirale logarithmique avec, en son centre, la silhouette noire de Scottie tourbillonnant dans l’abîme en tentant de retenir un fantôme de femme. C’est l’affiche du film, à ceci près que c’est mon nom, et non celui de l’acteur qui incarne Scottie, Jimmy Stewart, qui se trouve en haut de l’affiche. Je suis donc devenu pour l’éternité Scottie Ferguson, l’homme qui ne peut empêcher les femmes de tomber dans l’abîme. C’est peu flatteur si l’on adopte la lecture « borgésienne » de Vertigo que je propose, qui fait de Scottie un impuissant sexuel.
Vous débutez votre excellent Vertiges. Penser avec Borges justement par une lecture de Vertigo, film auquel il est difficile de penser sans la partition de Bernard Herrmann, laquelle s’inspire de l’opéra de Wagner, Tristan et Isolde. Retrouvez-vous cette musique en Californie ?
Le générique génial que le graphiste Saul Bass a conçu pour Vertigo représente une spirale logarithmique qui s’enroule en s’en rapprochant d’un centre que jamais elle n’atteint, et qui de plus tournoie sur elle-même. Cette dynamique a un point fixe qui reste extérieur à la structure. C’est la figure du suspense. C’est aussi celle de Tristan. L’opéra débute par un accord qui appelle une résolution qui ne vient pas et qui n’adviendra que dans l’accord parfait final, quatre heures et demie plus tard, quand Tristan et Isolde auront enfin trouvé l’accomplissement de leur amour dans la mort. La mission de San Juan Bautista a dans le film d’Hitchcock un clocher du haut duquel la fausse Madeleine est censée se jeter dans le vide — un faux suicide qui est le cœur de l’intrigue. Or la mission actuelle ne possède aucun clocher, car elle l’a perdu dans le tremblement de terre de 1906 qui parcourut la faille de San Andreas, au-dessus de laquelle se trouve la mission.
Le film, la musique et la réalité forment un accord parfait.
J’ai eu pour étudiants plusieurs membres de ce qu’on a appelé plaisamment la PayPal Mafia. En particulier, Peter Thiel épisodiquement, Reid Hoffmann sérieusement, et probablement Elon Musk pour une heure seulement. Jean-Pierre Dupuy
Votre rapport à la Californie a-t-il changé ces derniers mois, depuis l’élection de Trump ?
C’est une question essentielle à laquelle je ne puis répondre en quelques mots.
Je me suis déjà beaucoup exprimé sur le sujet, en français et en anglais, au point même que je ne suis pas sûr que mon visa soit renouvelé. Ou, s’il l’est, je n’écarte pas qu’une fois sur place, des individus cagoulés et de noir vêtus m’interpellent en pleine rue et me poussent dans une camionnette noire sans plaque d’immatriculation pour ensuite m’envoyer sans autre forme de procès vers un camp salvadorien où l’on m’oubliera. Le régime qui se met en place n’est ni une dictature, ni une variété de fascisme, mais, selon le mot du grand historien américain qui s’est exilé au Canada, Timothy Snyder, un terrorisme d’État. En face, que voit-on, y compris à gauche ? Des gens qui ont peur, j’en ai déjà parlé. Ce qui se passe est une tragédie.
Avez-vous côtoyé ou du moins croisé à l’université des personnalités proches de l’actuelle administration américaine, comme Peter Thiel ou Elon Musk par exemple ? Racontez-nous.
À Stanford, à la charnière des années 1980 et 1990, j’ai eu la chance d’avoir eu pour étudiants plusieurs membres de ce qu’on a appelé plaisamment la PayPal Mafia. En particulier, Peter Thiel épisodiquement, Reid Hoffmann sérieusement, et probablement — mais je ne m’en suis pas aperçu — Elon Musk pour une heure seulement. Tous trois sont devenus multimilliardaires, ce qui ne m’a pas enrichi d’un centime de dollar. Ensemble, ils ont créé PayPal, le service de paiement sur Internet, qu’ils ont revendu pour un milliard et demi à Ebay. Chacun a empoché sa part et ils se sont engagés sur des voies différentes. Thiel a financé Mark Zuckerberg créant Facebook, fondé Palantir, la boîte d’espionnage aux techniques sophistiquées et, s’engageant politiquement, a d’abord financé des libertariens puis s’est rangé en 2016 auprès de Trump. De tous les techno-milliardaires, il était le seul à le faire. S’il cherchait le pouvoir, il a eu une prescience remarquable puisque huit ans plus tard, la plupart ont fait le même choix. Reid Hoffman, lui, a créé LinkedIn et a mis sa fortune au service du parti Démocrate.
Je les vois assez régulièrement l’un et l’autre et leur conversation est fascinante d’intelligence. Bien que de bords complètement opposés, ils restent amis. Ils ont été formés à la pensée de René Girard, qu’ils ont interprétée chacun à sa manière. Ai-je besoin de rappeler que Thiel a fait lire Girard à son dauphin, J. D. Vance, que celui-ci s’est converti au catholicisme et qu’il est devenu Vice-Président des États-Unis ? J’ai développé ailleurs la thèse que les maux de l’Amérique trouvent leur origine dans diverses versions corrompues du christianisme 2.
Mais le moment où j’ai été le plus proche du pouvoir, je le dois à mon amitié avec Jerry Brown.
Brown fut gouverneur démocrate de la Californie quatre fois — un record — de 1975 à 1983 puis de 2011 à 2019. C’est Ivan Illich, ce grand critique des sociétés industrielles avec qui j’ai collaboré pendant dix ans, qui nous a réunis au milieu des années 1970. Ma collaboration avec Brown a consisté en de longues conversations chaque fois que je me trouvais en Californie. Un journal de San Francisco a même affirmé en 2016 que j’étais responsable du « catastrophisme » de Brown et de son surnom de « Moonlight Governor », c’est-à-dire de quelqu’un qui a constamment la tête dans les nuages — imputation largement exagérée ! Maintenant qu’il n’est plus aux affaires, Brown vit dans son ranch mais il est toujours très actif dans deux domaines qui sont aussi les miens : la possibilité d’une guerre nucléaire mondiale et le changement climatique.
Le Pacifique sera toujours là quand l’humanité se sera fait sauter dans un feu d’artifice atomique. Jean-Pierre Dupuy
Y a-t-il un livre ou un auteur que vous rattachez assez immédiatement à la Californie ?
Je pourrais bien sûr vous citer des auteurs célèbres dont l’œuvre s’est formée, partiellement ou totalement, en Californie où fut inspirée par elle, et que j’aime lire et relire : John Steinbeck, James Ellroy, Joan Didion, Mark Twain, Raymond Carver, Henry Miller ou Dashiell Hammett.
Mais je préfère évoquer le poète Robert Frost que j’ai cité en commençant notre entretien.
Né à San Francisco en 1874, il y passa les onze premières années de sa vie jusqu’à la mort de son père, après quoi sa mère l’amena dans sa Nouvelle Angleterre natale. L’essentiel de l’œuvre de Frost porte sur les zones rurales de la côte Est, mais j’ai une tendresse toute particulière pour les poèmes qu’il a écrits sur la Californie. Ils m’ont fait voir la beauté sans pareille de cet océan Pacifique, bien mal nommé, qui m’avait tant rebuté au départ.
Quel est votre endroit préféré en Californie ? Une ville, un lieu en particulier, un restaurant, une bibliothèque ou une librairie ?
À la fin du XVIIIᵉ siècle et au début du XIXᵉ, la couronne espagnole établit vingt-et-une missions sur la côte californienne, gérées par des moines franciscains.
Beaucoup sont très belles et ont joué un rôle notable dans l’histoire de la Californie.
Le moine Junípero Serra en fut l’un des artisans principaux, et son patronyme se retrouvait partout dans l’État, à l’université Stanford en particulier, nommant rues, immeubles et amphithéâtres. Ce n’est plus le cas. La communauté amérindienne du campus a réussi à convaincre l’administration que ce nom devait être banni, l’intéressé étant déclaré coupable de prosélytisme excessif. Deux statues le représentant à San Francisco ont été déboulonnées. Les justiciers n’ont toutefois pas osé exiger, pour l’instant, que le nom de la ville, une référence évidente au fondateur de l’ordre franciscain, soit changé.
Le film Vertigo, je l’ai dit en passant, s’articule autour de deux de ces missions, la mission Dolores, à San Francisco, et la mission de San Juan Bautista, au sud de la Bay Area. Mais c’est une autre mission que je veux nommer en réponse à votre question : la mission San Carlos Borromeo qui se trouve dans la petite ville de Carmel-by-the-Sea, au bord du Pacifique, entre la péninsule de Monterey et Big Sur.
La grande beauté de son église et de son site s’accorde à mon histoire personnelle, ce qui justifie ce choix.
Sur le campus de Stanford.
Y avez-vous une promenade sacrée ?
Le mot « sacré » est sans doute trop fort et je parlerai plutôt de communion avec la nature.
Je suis évidemment tenté d’évoquer des balades fabuleuses sur les collines qui surplombent l’océan, à Mendocino au nord de Bodega Bay ou à Point Reyes, un cap vertigineux à 50 kilomètres au nord du Golden Gate Bridge.
Le Pacifique sera toujours là quand l’humanité se sera fait sauter dans un feu d’artifice atomique.
La nature a en revanche produit dans ce coin du monde une créature fantastique et en principe pérenne que l’homme est en train de détruire irrémédiablement : certains des séquoias géants qui peuplent la Californie du Nord ont plus de 3000 ans et atteignent 115 mètres de haut. À l’échelle géologiquement minuscule de quelques siècles, leur survie est aujourd’hui menacée, tant par les incendies de plus en plus fréquents et intenses que par la disparition progressive, année après année, des brouillards matinaux dont s’abreuvent les arbres. Dans l’un et l’autre cas, le changement climatique est en cause.
Dans une scène intense et énigmatique de Vertigo, la fausse Madeleine analyse à destination de Scottie les anneaux de croissance, appelés cernes, d’un séquoia sectionné. Elle montre le point sur l’arbre qui correspond au moment où elle est censée être née. L’intrigue implique que cette scène se passe près de San Francisco, dans la forêt de séquoias sempervirens de Muir Woods, immédiatement à la sortie du Golden Gate. En réalité, Hitchcock l’a filmée dans une forêt encore plus belle, le parc de Big Basin Redwoods, dans la montagne de Santa Cruz au sud de la Bay Area.
C’est là que j’aime me promener, au milieu de ces géants majestueux que je préfère tenir pour immortels — alors que je sais très bien qu’ils sont en train de périr de la bêtise des hommes.
Sources
Jean-Pierre Dupuy, Vertiges. Penser avec Borges, Seuil, Coll. La Librairie du XXIème siècle, 2025.
Jean-Pierre Dupuy, La Marque du sacré, Flammarion, Champs Essais, 2010.
On connaissait le Toulon " olé olé " ou le Toulon insolite mais pas encore le Toulon durant la Seconde Guerre mondiale. Organisée par le Mémorial du Débarquement et de la Libération en Provence, cette visite guidée est pour la première fois proposée aux estivants. Ou comment découvrir la capitale du Var en se nourrissant d’anecdotes historiques à son sujet.
En voici cinq (parmi d’autres), racontées par Enzo Maurel, le médiateur culturel chargé de cette déambulation dans le temps.
Une plaque rend hommage aux victimes des bombardements
Le début de ce parcours urbain est fixé au monument aux morts, place Gabriel-Péri. "Une plaque y figure “à la mémoire des victimes civiles des bombardements de Toulon“", signale Enzo Maurel. "Pour affaiblir l’ennemi et préparer le Débarquement de Provence, les alliés ont ainsi visé, depuis le ciel, les Allemands qui occupaient le port de Toulon".
Près de 1.000 civils périront entre Toulon et La Seyne lors des huit bombardements qui frapperont la ville entre novembre 1943 et août 1944.
Le Grand hôtel ou les abords de l’opéra investis par l’ennemi
"La commission d’armistice italo-allemande occupait le Grand hôtel, sur la place de la Liberté, en 1940", souligne Enzo Maurel, devant les touristes admirant l’architecture raffinée de l’immeuble. À côté de l’opéra, rue Molière, "le bâtiment accueillait la milice et la ligue des volontaires français", deux mouvements vichystes tristement célèbres pour leur collaborationnisme.
Les halles portent le nom d’une grande résistante
L’exploitation des lieux par la marque basque Biltoki ne doit pas faire oublier l’histoire des halles. En 1956, celles-ci ont pris le nom d’Esther Poggio, une revendeuse qui travaillait dans le "ventre de Toulon". "C’est un des rares monuments à porter le patronyme d’une femme", explique Enzo Maurel. "Et pour cause: il s’agissait d’une jeune résistante qui travaillait ici avec ses parents, cachant même des armes au sous-sol."
Aujourd’hui, une plaque lui rend hommage et rappelle que cette agente de liaison a été arrêtée et fusillée le 15 août 1944.
La déportation organisée depuis la place Puget
C’est une petite porte rouge, au milieu de la place Puget, à laquelle personne ne prête attention. "Ici, il y avait le commissariat aux questions juives", annonce le guide. Le 26 août 1942, quarante personnes seront arrêtées à Toulon et déportées.
Enzo Maurel raconte que sa grande tante, l’écrivaine et poétesse Micheline Maurel, a elle aussi été envoyée à Ravensbrück pour son rôle jouée dans la Résistance.
Des rugbymen du RCT ont donné leur vie
Le stade Mayol a accueilli nombre de rugbymen talentueux mais également quelques héros de la Seconde Guerre mondiale. "C’est notamment le cas d’Henri Laugier, ou encore de Joseph Lafontan", rappelle Enzo Maurel.
Le pilier droit varois, dans l’équipe qui remportera le premier titre de champion de France du RCT en 1931, est "un martyr de la Résistance", fusillé à Beaulieu pour un acte de sabotage sur un poste électrique. La tribune présidentielle porte aujourd’hui son nom.
Savoir +
Balades urbaines du Mémorial:
- Toulon durant la Seconde Guerre mondiale: vendredis 8 août, 15 août et 22 août à 10h (durée 1h30). Point de départ au monument aux morts.
- La Libération de Toulon: jeudi 28 août et vendredi 29 août à 10h. Point de départ devant la fac de droit.
Gratuit. Réservation obligatoire: mediation.montfaron@onacvg.fr
Lors d’une audition publique au Sénat, Microsoft France a confirmé qu’elle ne pouvait empêcher la justice américaine d’accéder aux données hébergées en France. Un aveu glaçant, qui révèle l’ampleur du décalage entre les promesses de souveraineté numérique et la réalité contractuelle de l’État français.
Le 10 juin 2025, la commission d’enquête sénatoriale sur la commande publique a reçu Microsoft France pour une audition très attendue. Ce qui s’y est dit n’a laissé aucune place à l’ambiguïté : le droit américain s’impose, même lorsque les données sont hébergées à Paris ou Marseille. Et l’aveu n’est pas venu d’un militant ou d’un expert extérieur, mais du directeur juridique de Microsoft France lui-même.
Cloud Act : Microsoft ne peut pas empêcher l’accès du gouvernement américain aux données françaises
Face aux sénateurs, Anton Carniaux, directeur juridique de Microsoft France, n’a pas tourné autour du pot. À la question de savoir si Microsoft pouvait protéger les données françaises d’une injonction américaine, il a répondu, sans détour :
Si nous sommes contraints par une décision de justice américaine, nous devons remettre les données.
Le Cloud Act, adopté aux États-Unis en 2018, oblige toute entreprise américaine à répondre à une réquisition judiciaire, y compris pour des données stockées à l’étranger. Microsoft, bien que disposant de centres en France, reste juridiquement soumise à ce cadre. Le lieu de stockage ne fait donc pas barrière au droit.
Ce qui trouble davantage, c’est que l’État français continue d’acheter massivement des services Microsoft via l’UGAP, notamment par le marché “multi-éditeurs logiciels”, dans lequel Microsoft Ireland agit en tant que fournisseur. Des milliers d’administrations, d’hôpitaux ou de collectivités utilisent ainsi Microsoft 365 ou Azure, souvent sans conscience des conséquences juridiques. Même si l’hébergement est local, le risque reste transatlantique.
Et le problème ne vient pas seulement de Microsoft. Lors de la même audition, la DINUM (Direction interministérielle du numérique) a reconnu que les exigences de souveraineté définies par l’État ne sont pas encore appliquées de manière complète. Autrement dit, les marchés publics continuent de passer par des solutions non conformes, malgré la doctrine officielle.
Les conditions de souveraineté, telles qu’elles ont été définies dans la doctrine de l’État, ne sont pas encore appliquées de manière complète.
Microsoft, de son côté, met en avant des garde-fous : contestation des demandes abusives, rapports de transparence, chiffrement avancé, projet de cloud souverain avec gouvernance européenne. Mais même ces dispositifs, aussi sérieux soient-ils, s’effacent dès lors qu’un tribunal américain prononce une injonction.
Lyon : passage à l’acte pour la souveraineté numérique
En réaction à ces failles, la ville de Lyon a décidé de rompre avec la suite Microsoft Office. Selon la mairie, cette décision s’inscrit “dans un contexte de prise de conscience croissante des enjeux de souveraineté numérique ”. Elle adopte la suite libre Territoire Numérique Ouvert, développée avec le SITIV, hébergée dans des datacenters régionaux, et remplaçant progressivement Microsoft par OnlyOffice, Linux et PostgreSQL.
Lyon fait office de cas d’école : une collectivité publique qui met en œuvre des solutions localisées, libres et maîtrisées, afin d’échapper au poids des lois extraterritoriales.
Spoiler : ce n’est pas (que) sa faute. C’est probablement aussi la tienne.
Commençons par un fait : l’Internet d’aujourd’hui est un gigantesque buffet à volonté pour la connerie humaine. Une sorte de McDo cérébral où tu choisis ton complot préféré, tu l’arroses d’indignation bien grasse, et tu termines avec un petit milkshake de désinformation algorithmique. Bon appétit !
Mais rassure-toi, ce n’est pas juste un sentiment. Non. C’est théorisé. Documenté. Et même prophétisé, bien avant que Zuckerberg ne décide de transformer la planète en un cirque de contenus sponsorisés pour crétins.
Il y a 80 ans, Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand et antinazi (donc, spoiler : pas TikTokeur), posait un constat glacial : "La stupidité est plus dangereuse que la méchanceté." Et ce n’est pas une punchline de philosophe. C’est une analyse chirurgicale de ce qui transforme un peuple de penseurs en applaudisseurs de génocide. Rien que ça.
Mais attends, c’est pas fini. Dans les années 70, Carlo Cipolla, économiste à lunettes et à l'humour discret, enfonce le clou avec ses "5 lois fondamentales de la stupidité humaine". Et autant te dire que le bonhomme n’avait pas prévu les stories Instagram, mais on jurerait qu’il les avait prédites.
Stupide un jour, stupide toujours ? Pas exactement…
Bonhoeffer nous balance une idée aussi simple qu’explosive : la stupidité n’est pas un manque d’intelligence. C’est un choix. Un abandon. Un acte de soumission mentale.
Oui oui, ton pote ingénieur qui partage des mèmes antivax n’est pas “bête”. Il est juste stupide au sens moral du terme : il a choisi la facilité du groupe plutôt que la peine de penser.
"Des gens brillants peuvent être stupides, et des gens simples peuvent être lucides." - Dietrich, qui ne trollait pas, lui.
Et c’est ça le drame : tu ne peux pas raisonner la stupidité. C’est imperméable. C’est le gore-tex du cerveau.
Cipolla, lui, a chiffré la catastrophe
Petit best-of de ses lois :
• On sous-estime toujours le nombre de gens stupides. Toujours. Même toi, là, en ce moment.
• Ils sont partout. Toutes les catégories sociales. Du PDG au postier. De la star de télé-réalité au prix Nobel.
• Ils causent du tort aux autres sans bénéfice personnel. Ni pour eux. Ni pour personne. C’est du sabotage en roue libre.
• Ils sont imprévisibles. Impossible à anticiper. Comme un bug dans la matrice.
• Ce sont les plus dangereux. Oui, plus qu’un criminel rationnel. Parce qu’un abruti, lui, agit sans plan. Et souvent, en souriant.
Du fascisme à Facebook : même combat cognitif ?
Alors non, on ne dit pas que Meta = Hitler (quoique, certains jours…). Mais les mécanismes psychologiques sont les mêmes. Ce que Bonhoeffer décrivait en 1942 se rejoue chaque jour dans ton feed :
• Abandon de la pensée critique ? Check.
• Soumission au groupe ? Double check.
• Refus des faits qui dérangent ? Tonton Gérard t’appelle sur WhatsApp pour t’expliquer que Pfizer est une entreprise sataniste.
Et pendant que tu cries dans le vide, l’algorithme, lui, encaisse les biftons !
C’est du “Stupidity-as-a-Service” (SaaS), et ça génère un R.O.I. (Retour sur investissement, pour ceux qui ne suivent pas) bien plus solide que la raison. L’engagement avant la vérité. L’émotion avant la réflexion. TikTok, c’est Bonhoeffer, mais avec des filtres chiens.
America first… en stupidité collective
Tu veux des chiffres ? En 2020, 47% des Américains connaissaient QAnon. Et 41% des républicains exposés trouvaient ça “bénéfique pour le pays” (Pew Research). Oui, bénéfique. Comme une lobotomie à la perceuse.
Et pendant ce temps, les fake news se propagent 6 fois plus vite que les vraies infos (MIT). Six. Fois !
Ce n’est pas simplement de la bêtise, c’est de la connerie orchestrée à grande échelle !
Mais que faire ? (à part tout brûler)
Bonhoeffer te le dit : tu ne peux pas convaincre un stupide. Tu peux hurler, présenter des preuves, leur faire un PowerPoint animé… Rien. Nada. Ils deviennent hostiles. Comme un anti-virus qui détecte la logique comme une menace.
Ce qu’il faut ? Créer les conditions de la libération.
Pas les convaincre. Les libérer. Lentement. Patience et amour (ou alors, fuir loin dans les bois).
Exemples de libération réussie :
• La Finlande, qui apprend aux enfants à fact-checker dès la maternelle. Résultat ? 69% de confiance dans les médias (vs 29% aux USA).
• Les programmes de désintox sectaire à base de dialogue bienveillant et de reconnexion sociale.
Les hacks anti-stupidité (à usage quotidien)
• Dans la vie pro :
- Slack + validation croisée = moins de décisions débiles.
- Pre-mortem = anticiper la connerie avant qu’elle ne frappe.
- Ne jamais promouvoir un abruti par compassion. C’est cruel pour tout le monde.
• Dans la vie perso :
- Technique du grey rock : sois chiant, fade, inintéressant avec les complotistes.
- Script de sortie : "Hmm, intéressant, je vais y réfléchir." Puis tu fuis.
- Rituel du soir : note UNE stupidité que tu as faite dans la journée. Parce que oui, toi aussi.
Et pour notre hygiène numérique ?
- Agrégateurs non algorithmiques : AllSides, Ground News…
- Quarantaine mentale : 48h avant de partager une info “choc”.
- Audit de ta bulle : force-toi à lire des sources qui te contredisent.
Et surtout : accepte ta vulnérabilité. Parce que si tu penses que tu es immunisé… tu es déjà contaminé.
Le mot de la fin
La stupidité n’est pas une fatalité biologique. C’est un engrenage social. Un bug moral. Et le plus souvent, un business.
Mais à la différence des Allemands de 1942, on a accès aux outils. Aux études. Aux mécanismes. Et à Bonhoeffer et Cipolla, ces deux mecs bien trop lucides pour leur époque.
Alors à toi de jouer.
Ne sois pas le maillon faible du réseau neuronal collectif.
Pense. Résiste. Libère. Et surtout : désactive les notifications.
Sources multiples :
- Korben
- pewresearch
- Reuters
- Le Parisien
- M.I.T
L’édito de Pierrick
Avec Willy, développeur dans l’équipe, on travaille en ce moment sur un gros projet d’intégration de l’intelligence artificielle dans Piwigo. L’idée n’est pas de surfer sur la tendance de l’IA mais de l’utiliser de façon réellement utile. Pour le moment, tout n’est pas encore prêt, mais on s’est dit que ça vous intéresserait d’en savoir plus dès maintenant 🙂
Pourquoi utiliser l’IA dans Piwigo
Vous vous demandez peut-être :
“Mais en quoi l’intelligence artificielle peut-elle être utile dans Piwigo ?”
La réponse la plus évidente, c’est l’automatisation de l’indexation des photos, avec par exemple l’ajout automatique de mots-clés.
Le moteur de recherche de Piwigo repose sur les informations textuelles associées aux images : titre, description, tags, albums…
Mais si vos photos sont toutes dans un dossier “vrac”, nommées IMG_0123.jpg, sans description ni mot-clé, alors ce moteur devient inutile.
Vous pourrez peut-être filtrer par date ou format, mais pas beaucoup plus.
Pour que la recherche soit pratique, il faut donc indexer les photos en ajoutant des titres, descriptions, tags… Ce travail d’indexation est essentiel… et chronophage.
⇒ L’IA permet de faire une première passe automatique, en quelques secondes par image. Nos tests montrent que les résultats sont bons.
Vous pouvez ensuite relire, corriger, compléter. Et vous obtenez une photothèque bien mieux organisée, prête à être explorée.
Si vous voulez, vous pouvez découvrir ci-dessous des maquettes (non contractuelles !) de ce que pourrait donner l’intégration de ces fonctionnalités dans Piwigo.
Traitement d'une série de photos par IA au téléchargement
Ce qu’on avait déjà… et ce qui posait problème
Depuis quelques années, il existe un plugin développé par Zacharie : Tag Recognition. Il s’appuie sur des services externes (Microsoft ou Imagga) pour analyser une photo et proposer des tags.
C’est efficace, mais :
Ce sont des services fermés, dont on ne maîtrise ni le fonctionnement ni les conditions d’utilisation. Et ça va à l’encontre de l’esprit de Piwigo : garder le contrôle sur ses données.
Ils sont chers. Imagga, par exemple, est récemment passé à 70 $/mois pour une utilisation de base. C’est trop.Ce qui a changé
Les évolutions récentes de l’IA ouvrent de nouvelles possibilités. Aujourd’hui, il est possible de faire tourner des modèles IA open source, chez soi ou sur un serveur dédié.
Pas sur un petit hébergement partagé, mais sur une machine un peu plus costaud… comme celles que nous louons et administrons pour la plateforme piwigo.com.
C’est exactement ce qu’on met en place. Pigolabs, la société qui développe Piwigo.com, va héberger un service IA qui permettra à tous les Piwigo (auto-hébergés compris) de profiter de traitements automatiques, via un plugin : Piwigo AI.
Ce que Piwigo AI sait déjà faire
Voici les traitements déjà disponibles dans la première version du projet :
Ajout automatique de mots-clés
Génération de descriptions
Reconnaissance de texte dans l’image (OCR)Et ce n’est qu’un début. D’autres fonctionnalités viendront dans les prochaines versions.
Et mes données dans tout ça ?
C’est une priorité pour nous : vos données restent à vous.
Le serveur d’IA que nous mettons en place :
ne connaît pas l’URL de votre Piwigo,
supprime les données dès que l’analyse est terminée.Il reçoit une demande, traite l’image, envoie le résultat, puis efface tout.
Nous ne stockons rien, nous n’analysons rien d’autre, et nous ne cherchons pas à collecter d’informations. Point.
Le modèle économique
Ce service ne sera pas gratuit. Pour deux raisons simples :
Il a un coût (serveurs, maintenance, R&D…), et il faut que ce soit viable à long terme.
Le gratuit incite souvent à la surconsommation. Or, faire tourner des serveurs d’IA a un impact environnemental réel. Il faut encourager une utilisation raisonnée.Le modèle qu’on envisage : un système de crédits.
Vous aurez des crédits gratuits pour tester. Et si ça vous plaît, vous pourrez en acheter d’autres, à utiliser quand vous le souhaitez.
Une intégration fluide dans votre Piwigo
Pour que tout cela fonctionne, il faut que l’analyse soit simple, rapide, intégrée dans votre routine.
C’est là qu’on met le paquet : Alice travaille sur les maquettes d’interface, Willy commence l’intégration. Une première version du serveur est déjà fonctionnelle.
Maintenant, le plus dur va être de rendre tout ça fluide dans Piwigo.
Concrètement, vous pourrez lancer une analyse :
à l’ajout d’une photo,
depuis la gestion par lot,
dans l’édition d’une photo individuelle.Et vous pourrez choisir les traitements à appliquer. Par exemple, ne faire que de l’OCR pour économiser vos crédits.
Voilà où on en est.
C’est un projet ambitieux, et on voulait vous en parler dès maintenant. On sait que l’IA peut susciter des questions — à juste titre — et on veut avancer en toute transparence.
Comme toujours, vos retours sont les bienvenus !

